

L’homme politique comme déchiffreur de rêves
Source : Stéphane Douailler
Ne pas borner notre action politique à l’horizon de nos cités et des façons que nous avons d’y mener nos affaires, traiter des questions politiques comme de questions sans frontières, semble bien être depuis longtemps le moins que nous puissions faire. L’espace politique déployé par la politique possède assurément en lui le pouvoir, et parfois le devoir, d’être porté à la puissance d’un espace sans frontières. Comment comprendre cela, cependant ? Où cela projette-t-il ? Vers deux choses au moins, semble-t-il. D’abord vers une nature. Pour autant que frontières signifie des tracés, des découpages, des démarcations, des fossés inventés et mis en œuvre par des hommes, la projection dans un espace sans frontières mène ou ramène vers un rapport entre les hommes qu’on peut appeler naturel au sens où il se débarrasse de tout le poids coutumier et historique des frontières, et où il définit un rapport plus immédiat. Espace sans frontières signifie en second lieu une idée. Le rapport plus naturel et plus direct entre les hommes qui peut être établi indépendamment des frontières, par dessus elles et éventuellement en dehors de leur abolition réelle, est un rapport qui se soutient d’une idée, en particulier d’une idée de la nature, et qui assigne à cette dernière un certain statut.
On peut dire que cette compréhension de la politique est par exemple celle qu’illustrent à l’âge moderne le De Cive et Le Leviathan de Hobbes. Saisissant les hommes en dehors de leurs formes d’existence historiquement instituées, Hobbes les identifie à leurs volontés, facultés et droits naturels sur toutes choses c’est-à-dire à une certaine idée de leur nature, et pose la politique comme le calcul rationnel du jeu de forces instauré par cette identification. La formule retentissante l’homme est un loup pour l’homme énonce à la fois la naturalisation des rapports entre les hommes, et la possibilité de les soumettre aux calculs rigoureux dans lesquels l’homme s’assure la maîtrise des choses de la nature. Levant toutes les partitions et associations héritées, mettant virtuellement tout homme en rapport avec tout autre, elle rend les hommes disponibles à leur insertion dans un corps politique dont le pur artefact rivalise avec l’indifférence des réalités naturelles à l’endroit des affaires historiques et humaines, et qui se fait l’équivalent dans le monde humain des objets de pensée constitués par l’investigation galiléenne de la nature. Elle projette la politique dans un espace qu’on peut dire sans frontières au sens où sont et se veulent sans frontières humaines les objets de la nature étudiés par les sciences, et, à leur image, les politiques de l’âge des sciences.
En même temps, le raisonnement qui aboutit dans le De Cive et dans Le Leviathan à ce qui est apparu en ce sens comme une re-fondation moderne de la politique appelle peut-être aussi l’attention sur la façon dont Hobbes est amené à l’exposer et à lui donner cette consistance mi-historique mi-fictionnelle propre aux raisonnements dans les théories politiques du contrat social. Deux points semblent devoir être soulignés. D’abord, comme chacun sait, c’est la crainte et en particulier la crainte de la mort qui soumet à ses déterminations tout le calcul politique. Chacun le sait d’autant mieux que c’est en particulier au titre de ce trait qu’on reconnaît généralement à Hobbes d’avoir introduit à une pensée moderne de la politique et d’avoir substitué aux considérations anciennes du Bien et d’une providence divine celle d’un pouvoir sur sa vie sur le modèle de la maîtrise de la nature contenue dans l’essor des sciences. Le second point est le caractère entièrement imaginaire du calcul. Si l’on se reporte au treizième chapitre du Leviathan, on constate que le raisonnement qui conduit tout homme à craindre infiniment l’hostilité de l’autre est un raisonnement par lequel nous prêtons en réalité cette hostilité à l’autre comme simple possibilité. Nous nous saisissons de l’autre dans un exercice de notre imagination par lequel nous constatons que quelque noires que soient les intentions que nous lui attribuons elles peuvent toujours lui être attribuées. L’aspect pacifique, la vie tranquille, l’horizon borné de l’autre ne garantissent rien. Les apparences peuvent cacher – et d’autant mieux cacher qu’elles semblent inoffensives – la dangereuse réalité d’un homme embusqué se préparant à une guerre contre moi pour me ravir mes biens, faire de mes possessions une terre de conquête et de la ruine de mon établissement une occasion de gloire. L’homme est un loup pour l’homme n’est pas un fait mais un scénario de mon imagination, un cauchemar, une hantise contre lesquels rien ne peut me protéger et qui alors a pour effet de faire de moi petit propriétaire pacifique ne demandant qu’à vivre agréablement avec sa famille du travail de sa terre en bonne intelligence avec ses voisins cet agresseur même que je fantasme chez l’autre et dont je me prémunis en prenant rationnellement, comme écrit Hobbes, « les devants ». A chaque fois que les signes et les indices qui me décrivent l’autre sous une figure qui n’a pourtant rien d’un loup cèdent devant l’imagination, celle-là, en proie à ses spéculations, ne possède en elle-même aucun principe régulateur qui l’arrête sur la voie de lui prêter par hypothèse raisonnable les intentions et la nature dissimulée d’une bête féroce et d’aboutir à la conclusion que le fond naturel des choses est celui d’une guerre de tous contre tous. C’est précisément une des tâches que se donne leLeviathan d’identifier des signes et des indices qui fassent foi contre ces représentations de l’imagination et de soutenir une décision rationnelle qui, en instituant le contrat social et la république, mettent un terme aux spéculations imaginaires entre les hommes. La politique, pour Hobbes, doit être inauguralement libérée des rêves et des hantises des hommes, et devenir quant à son fond une affaire de réel et de raison.
Et alors surgit tout simplement une question. Est-il possible d’élever la politique à la puissance d’une politique sans frontières, de desserrer les pactes et les barrières au milieu desquels s’organise l’existence collective, de faire fond sur une proximité entre les hommes homogène à celle qui vaut pour les choses de la nature, sans être reconduit vers le même ou vers de semblables nouages politiques du rêve et du réel ? Il existe, bien entendu, toute une tradition explorant une autre voie, et il est possible ici d’attirer l’attention sur le De Josepho écrit au 1er siècle de notre ère par Philon d’Alexandrie dit Philon le Juif.
Philon écrit dans un contexte antique caractérisé par la perte d’autonomie des cités lors de la constitution de vastes empires tels que celui d’Alexandre, puis celui des empereurs romains. Il voit s’effondrer tous les régimes et tous les pactes particuliers sous la poussée d’un monde nouveau, et il est amené à comprendre, lui aussi, que ces bouleversements du paysage hérité de l’existence collective, et l’émergence d’associations nouvelles, se fonde sur une unité naturelle du mode de vie humain. « Ce monde où nous sommes, écrit-il, constitue une immense cité. Il n’existe qu’un seul régime et une loi unique, car c’est la raison de la nature qui ordonne ce qu’on doit faire et qui interdit ce qu’il faut éviter » (§29). Philon pose, au fond des choses, une universalité du genre humain et de la nature dans laquelle il vit. Pour tous existent de la même manière les conditions premières de la vie comme celles de sa possible perfection. Rien ne justifie en nature – et donc rien ne justifie durablement – la diversité des associations, des régimes, des lois. Les arguments qu’on prétend tirer souvent de la nature pour justifier cette diversité, l’invocation par exemple de l’inégale fertilité de la terre, d’une situation en bord de mer ou à l’intérieur des terres, et autres raisons de ce genre, sont de mauvais arguments. La diversité des associations, régimes, lois, tient, non pas à ces circonstances naturelles, mais aux ambitions des uns, aux défiances des autres, à l’amour des particularités, bref à toute une construction culturelle secondaire, passionnelle, contestable, de leur mode de vie par les hommes. Ce que Philon a sous les yeux, à savoir la destruction des règles et des situations anciennes, l’envahissement du monde pour une puissance unique et éventuellement par les rêves fous de cette puissance quand elle prend les traits de l’empereur romain contemporain de Philon : Caligula, cela a un fondement dans la nature, et c’est depuis cette nature qu’il faut repenser les possibilités de la politique.
Philon effectue cette réflexion sur le personnage biblique de Joseph, le fils préféré et tard venu de Jacob, dont l’histoire raconte que jalousé et vendu comme esclave par ses frères à des marchands de passage, ayant effectué par ses qualités et par sa droiture une ascension au sein de la société égyptienne, il se serait hissé finalement à la fonction de superintendant d’Egypte et aurait obtenu dans cette position la réparation des torts subis. Joseph représente, au sein de l’œuvre de Philon attachée à élucider différents genres de perfection à travers des vies exemplaires, la vie parfaite pour autant qu’elle peut l’être de l’homme politique. Saisissant cette vocation supérieure de Joseph à la politique dans une inspiration qu’elle aurait su reprendre, dans la perspective rappelée, dans la nature, Philon en décrit l’apparition dans deux rêves de Joseph enfant rapportés par le texte biblique. Dans le premier, Joseph rêve et raconte à ses frères qu’alors qu’il moissonnait avec eux sa gerbe se serait soudain dressée et tenue debout sur le champ, et que ceux-là se seraient émerveillés et se seraient prosternés devant elle avec la plus grande révérence. Dans le second, plus audacieux encore, il semble à Joseph voir le soleil, la lune et onze étoiles venir l’adorer. Rapportés par l’enfant en toute innocence – à en croire le texte – ces rêves illustrent bien politiquement ce qu’il est toujours possible selon Hobbes de craindre à l’état de nature, à savoir des désirs de domination qui ne se laissent arrêter par aucune hiérarchie ou égalité instituées mais prétendent aller au bout de leur puissance. Fils tard venu et préféré, Joseph rêve, comme le lui font remarquer ses frères, de « devenir leur roi et leur seigneur », puis, selon la suggestion que fait Jacob de reconnaître dans le soleil le père, dans la lune la mère et dans les onze étoiles les frères, de dominer sa famille et de lui imposer de l’adorer. Dès lors, l’illimitation de ces rêves lui enlevant en même temps que son nom d’enfant venu en plus la place assignée contenue dans ce nom, il devient aux yeux de ses frères simplement le rêveur, l’illuminé (§12) et par là même l’objet de leurs craintes et de leur colère, que, prenant les devants, ils décident d’éliminer.
L’élimination ne se fait pas cependant dans la pureté hobbesienne. Le cadre est, certes, celui d’un affrontement de bêtes féroces. Sans un mot les frères se jettent sur Joseph, le mettent nu, le précipitent dans une fosse pour le tuer plus tard, imprègnent son vêtement du sang d’un chevreau et déclarent au père qu’il a été dévoré par un animal sauvage. Mais ils ne parviennent pas à effectuer cet acte dans l’unanimité d’une décision rationnelle – le frère aîné se révèle encombré d’un respect dû au père et d’une volonté d’être un homme de bien – ni à l’accomplir jusqu’au bout – au lieu de le tuer ils s’en débarrassent en le confiant à l’institution de l’esclavage capable, pensent-ils, de les protéger des ambitions qu’ils ont perçues chez lui. Ainsi les frères de Joseph ne réussissent-ils pas à ce qu’il semble à déplacer entièrement sur le terrain de la nature leurs relations avec ce jeune frère qui ne joue pas le jeu de l’égalité entre frères ni le rôle dévolu à l’enfant venu en plus. Ils continuent à régler le problème de la pure puissance qu’ils décèlent dans ses rêves en rusant et mentant au sein des conventions et des institutions. En termes hobbesiens, ils ne franchissent pas le pas de comprendre que l’agir politique, dont le leur, est en son fond un jeu de forces entre bêtes féroces, et que c’est depuis cette compréhension qu’une solution politique protégeant de ce jeu de forces pourrait être rigoureusement pensée. Il n’appartiendra – dit-on dans cette conception – qu’à la modernité de dévoiler l’animal politique comme bête féroce et d’édifier sur cette donnée l’Etat comme réponse politique à cet état naturel des choses.
La construction de Philon d’Alexandrie est cependant, on l’a dit, différente. C’est dans la figure biblique de Joseph et non pas dans celle aboutie ou inaboutie des frères qu’elle déchiffre la figure de l’homme politique. Elle se saisit dans cette figure d’un dépassement qu’un certain art déployé par Joseph opère – dans d’autres termes que ceux que nous connaîtrions depuis Hobbes – par rapport à la politique qu’on pourrait dire ordinaire et conventionnelle des frères. Ce dépassement partage avec Hobbes de saisir la politique telle qu’elle se tient sur un fond des choses appelé nature ainsi que de le faire en proximité avec la compréhension qu’en toute rigueur, en toute volonté d’élucidation d’un fond des choses, s’efforcent pour leur part de donner de cette nature les sciences. Tel est en particulier le sens que, dans l’attention qu’il lui porte, Philon prend silencieusement pour guide dans le second rêve de Joseph enfant au sujet du soleil, de la lune et des onze étoiles. Ce rêve ne contient pas tant la sempiternelle signification familialiste du père, de la mère et des frères, que Deleuze a reproché à la psychanalyse de toujours redécouvrir partout avec excès et que le texte biblique fait précisément proposer par un père qui n’y croit pas trop lui-même, que la pensée de la situation d’un sujet rêvant par rapport à un monde tel qu’il obéit, de nuit comme de jour, que les hommes rêvent ou veillent, aux mouvements exacts des astres. Et tel pourrait être aussi bien l’un des sens que Philon aperçoit pour son propos dès le premier rêve à propos des gerbes, lequel, pour énoncer quelque chose de la place de Joseph par rapport à ses frères, le fait dans le contexte spécifique des moissons, qui obéissent aux astres, et non pas dans le contexte manifestement plus familier aux frères de la conduite des troupeaux, où les plus jeunes sont confiés à la direction des plus âgés. C’est à certains égards de la même façon que Hobbes cherchera à fixer une rationalité politique dans le contexte de l’élucidation galiléenne de la nature, et que Philon s’applique à déchiffrer la perfection politique dans celui de sa régularité astronomiquement fondée.
La différence entre Hobbes et Philon n’est pas entre une politique élucidée dans un cadre de pensée scientifique, et une politique qui ne le serait pas. Elle est une différence entre deux paradigmes scientifiques distincts, l’un dominé par le dynamisme physique de la mécanique, l’autre par la régularité géométrique des mouvements astronomiques. Et alors la différence entre eux est celle aussi bien des comportements humains associés, dans chacun des deux paradigmes, à leur compréhension du fond naturel des choses. Sur ce point, Hobbes et Philon apparaissent décrivant des comportements humains fondamentaux à certains égards strictement contraires. Là où Hobbes fait voir des volontés mettant activement en œuvre leur puissance, et, malgré leur profond désir de paix, entrant les unes avec les autres dans une guerre totale, Philon souligne chez Joseph l’acceptation sans condition de tout ce qui lui arrive. Chassé de chez lui par ses frères, vendu comme esclave, calomnié par la femme de Putiphar, jeté en prison, placé partout où il se trouve dans une position inférieure à ce qu’il est réellement, Joseph n’engage aucun conflit. Chez Philon, la nature est ce qu’il faut laisser agir en soi et à travers soi. Elle est ce qui toujours veille et accomplit ses mouvements géométriques exacts indépendamment de ce que nous en comprenons dans notre perception alternativement éveillée et endormie du réel. Ce qui, parce que Joseph précisément s’y soumet complètement, forme en lui à travers toutes ses épreuves l’homme politique parfait apprenant comme enfant l’art pastoral et les cycles végétatifs, comme serviteur vendu à Putiphar l’intendance d’une maison et les vertus qui l’accompagnent, comme homme jeté en prison au milieu des hommes les plus féroces la force éducative de la conduite exemplaire (Joseph transforme la prison en « école de philosophie »§85-87), enfin comme homme prisé pour son savoir et appelé auprès du pharaon l’art royal de gouverner. Chez Philon, la nature est cause des événements en tant que totalité organisée et mieux organisée que ne l’est aucun homme.
Rappeler cette représentation de la nature, telle qu'elle a effectivement séduit une partie des esprits dans l’Antiquité, et telle que Philon la reconstruit à partir de sources platoniciennes et stoïciennes, n’est évidemment pas le propos ici. Cette représentation présente des inconvénients majeurs. Parce que la nature s’exprime pour elle dans sa vérité dans la régularité des mouvements astronomiques, le monde humain ne peut en effet lui apparaître toujours que comme un désordre, que comme un monde dessaisi de sa propre régularité et devant tendre à la régularité supérieure des astres. D’autre part, elle ne compte pas non plus sur les actions humaines pour cela, mais plutôt sur une providence telle qu’elle gouvernerait bien plus sûrement le monde que les hommes. Mais représenter la nature sous la détermination de ces catégories anciennes d’un déficit du monde humain par rapport à l’ordre vrai des choses, et d’une providence, n’est pas non plus l’intention spécifique de Philon dans le De Josepho. Le propos de Philon est en cet ouvrage d’identifier l’exacte fonction de l’homme politique, et d’en produire une description supérieure sous la forme reçue dans l’Antiquité d’une vie parfaite. Philon ne repose tout le cadre d’une nature supérieurement réglée et transcendante aux affaires humaines que pour faire sortir du cadre étroitement humain, pour penser en dehors des frontières où se cantonne ordinairement l’agir des hommes, la vie et la fonction de l’homme politique dont il cherche à penser une vérité profonde.
Dans cette perspective, la réaffirmation par Philon que les affaires du monde obéissent à la souveraineté réelle de la nature a pour effet de poser que les affaires des hommes, les affaires politiques, existent quant à elles sur le plan d’une « addition à la nature » (§28). Les hommes créent des associations, des régimes, des lois qui n’atteignent à aucune signification du point de vue de la nature essentiellement une, qui ne possèdent pas de sens ultime, qui peuvent toujours être levés, déplacés, réorganisés, et qui constituent la sphère de l’agir politique des hommes précisément comme addition. Comme chez Hobbes, la référence à la nature sert à dévoiler la sphère politique comme sphère de passions, d’ambitions, de relations de mauvaise foi, de recherche d’avantages, d’accords et de désaccords guidés par l’opinion (§30). Elle est la sphère ajoutée à la nature dans laquelle aucune institution, en tant justement qu’ajout, n’est assurée de sa stabilité. Qu’est-ce qui a cours dans le monde politique ? L’enthousiasme de la jeunesse, le sérieux de l’homme fait, l’expérience des anciens. La séduction, l’énergie, la persévérance. La puissance économique, la force militaire, la renommée. Rien de tout cela – selon un sentiment profondément ancré dans le monde antique – n’est stable. Tout, ainsi que Hobbes le retrouvera par une autre voie, est exposé à être bouleversé, renversé, anéanti (§127-142). Philon pourrait même être dit en accord avec Hobbes sur la compréhension à avoir de l’écart de la nature additive de la politique, pour autant que chez l’un comme chez l’autre la politique naît de la distance du monde imaginaire des hommes au monde réel, et que chez l’un comme chez l’autre l’art politique consiste à soumettre cette distance à un travail de la pensée. Mais là, aussi bien s’arrêtent les ressemblances. Le travail de pensée à faire sous le nom de politique prend des aspects opposés, comme prenait des aspects opposés, on l’a vu précédemment, le comportement humain fondamental aperçu par l’un et par l’autre à la lumière de sa compréhension de la nature.
Chez Hobbes, la perception imaginaire – constitutivement humaine – que les hommes se font du monde n’est posée comme l’espace même où s’institue la politique que pour être aussitôt abolie comme lieu de la politique. Hobbes déchaîne en quelque sorte d’un coup la puissance de l’imaginaire et l’ouverture du monde politique qui lui est associée, et ce coup demeure indéfiniment joué. Il effectue l’ouverture d’un monde politique dans une opération de pensée qui, du premier coup où elle a lieu, va jusqu’au bout de ce qui serait à penser pour effectuer cette ouverture, et qui signifie alors aussi bien une double fin de la politique. D’abord, il n’y aurait plus en effet de coup nouveau à jouer, en tout cas plus de coup modifiant profondément les choses, la sphère politique aurait été dans l’ensemble définitivement et complètement ouverte par le coup de Hobbes. Ensuite, en posant que l’image dernière qui procure cette ouverture complète de la politique est celle du loup pour l’homme, l’opération de pensée de Hobbes ne manque pas de parvenir effectivement à une butée, à une figure d’homme avec laquelle on ne peut pas continuer d’imaginer de jouer, et qui alors provoque un reflux de l’imagination vers une « loi de nature » prêtée par Hobbes à tous les hommes de vouloir malgré tout jouir du bonheur et de la paix, et vers son accomplissement dans une domination positive et technique de la nature sous la protection d’un Etat fort.
Et ce qu’on peut voir alors chez Philon, c’est que les opérations de pensée qui ont affaire au même contenu, c’est-à-dire au monde ajouté de la politique, peuvent être effectuées tout autrement. Avant tout, Philon ne nomme pas seulement imagination ou production imaginaire – comme il a été plus ou moins dit jusqu’à présent dans une proximité à Hobbes – ce dont il s’agit dans ce monde ajouté, mais rêve. Le rêve présente au moins deux différences par rapport à l’imagination. Alors que l’imagination se déploie comme une faculté à côté d’autres facultés : la sensation, la mémoire, le calcul rationnel, le rêve est une activité de pensée qui mobilise l’ensemble des puissances et des formes de la pensée. Et, alors que l’imagination propose en tant que faculté spéciale de simples variations au sujet des éléments perçus, mémorisés ou intelligemment combinés, et demeure – quelles que soient ses fantaisies et ses audaces que Hobbes prétend épuiser d’un seul coup – au sein d’un même monde, le rêve, comme chacun sait, fait entrer dans un autre monde. Il opère même pour Philon un acte plus spécifique, pour autant que ce serait encore s’exprimer de façon inadéquate que de dire qu’il nous fait entrer dans un autre monde. Plus exactement, le rêve dédouble le monde en nous laissant dans une incertitude de savoir quels sont et comment se partagent les deux. C’est aussi bien quand ils sont éveillés, précise Philon, que les hommes rêvent. Par le rêve, par ce que Philon nomme le rêve, la politique a affaire à tout le sentir et pensable des hommes en tant que celui-ci ne serait pas spécialement attaché aux déterminations de l’existence éveillée et à celles de ses variations imaginées ou rêvées, mais en tant qu’il constitue en lui-même un monde du sentir et du pensable que Philon nomme « le grand rêve, général et public, de ceux qui veillent comme de ceux qui dorment » (§125).Ce rêve est proprement, dit Philon, pour parler en toute vérité, « la vie des hommes » (§126), susceptible aussi bien d’être entendue comme celle des individus, des cités, des peuples, des provinces, des nations, des continents (§134).
Et si le contenu de pensée dont la politique a à se saisir est ce rêve qu’est la vie des hommes, nul, bien entendu, ne peut prétendre l’épuiser d’un coup. Il doit toujours être soumis à des déchiffrements singuliers, et telle est justement la fonction que Philon reconnaît à l’homme politique. Ce dernier est bel et bien, dit-il, un « déchiffreur de rêves » (§125). Et, dans ces conditions, pourrait-on ajouter, il ne saurait non plus y avoir d’image dernière, celle d’un loup pour l’homme, ou toute autre. Il n’y a de politique, au contraire, que parce qu’il n’y a pas d’image dernière, situation que nomme en particulier, pour se référer aux travaux de Jacques Rancière, l’esthétique.


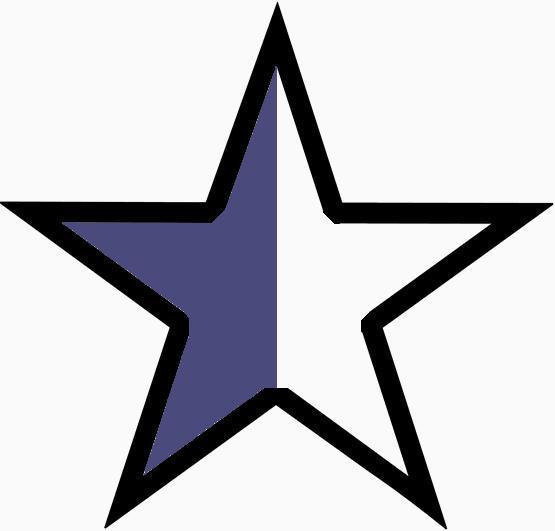
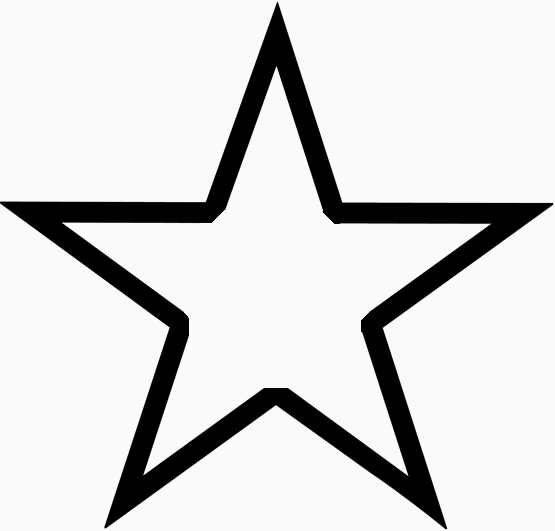


 Actualités
Actualités













