

Politique culturelle: derrière le rideau magique de la culture universelle surgit le droit culturel et ses contrats
Source : Jean-Michel Lucas
Le 7 juin 2006, la revue Mouvement organisait une rencontre nationale sur le thème de la "Culture Publique", prolongeant ainsi la publication de quatre opus sur le même sujet aux éditions (mouvement)SKITe/Sens et Tonka. Les débats furent précédés de lectures de documents d’archives se référant entre autres à Malraux, Mitterrand, Lang, Vitez. On retrouvera ces documents dans les quatre tomes : L’imagination au pouvoir, Les visibles manifestes, L’art de gouverner la culture, La culture en partage. L’intervention suivante prend appui sur ces lectures pour interroger l’arsenal vacillant des légitimités historiques de l’action culturelle publique, en France.
À l’écoute des paroles fortes qui ont introduit cette discussion, on entend l’évidence : il y a bien dans tout cela matière à croire à la politique publique de la culture. De Malraux à Lang, de Mitterrand à Vitez, ces mots d’archives semblent encore aujourd’hui des mots d’avenir, qui appellent aux rêves, nourrissent l’imaginaire d’une utopie où l’art serait au cœur de la société, pour la délectation de tous et de chacun. Ce sont des mots d’une politique publique qui se justifie par ses valeurs et ses principes.
Ce sont aussi des mots magiques où l’amour descend sur terre pour conduire la politique culturelle vers le sublime et la béatitude, dans l’excellence et l’exigence artistiques. Une culture de référence pour l’Homme dans son universalité. Le meilleur de nous-mêmes sans doute pour ne plus être simplement un demi gorille (1). «Une utopie féconde» disait aussi Jean Louis Fabiani en parlant de la nécessité de «la conversion de nouveaux publics à une culture absolue et universelle» (2).
Tous ces textes sont faits de «mots» un peu sorciers, qui envoûtent. «On nous détestera pour notre art et pour la signification publique de nos paroles feintes, de nos gestes empruntés d’acteurs, sur la scène» dit Vitez. «Le droit au bonheur, appelons-le aussi le droit à la beauté» dit Jack Lang et Malraux de conclure son discours de la maison de la culture d’Amiens : «mais il faut d’abord qu’il existe l’amour, car, après tout, dans toutes les formes d’amour, il ne naît pas des explications.»
Cette puissance de légitimation de l’intervention publique au bénéfice de l’art et de la culture semble inoxydable et le discours de l’inauguration de la maison de la culture de Grenoble par l’actuel ministre de la culture ne pouvait échapper au genre : «Nous inaugurons un lieu où la distance même qui séparait l’œuvre et son public est abolie», en ne manquant pas de pomper Malraux et son usage régulier d’Antigone : «Je ne suis pas venue sur la terre pour partager la haine mais pour partager l’amour» (3). «Il y a donc des paroles immortelles et ce sont seulement des paroles immortelles qui sont aussi puissantes que les puissances de la nuit!».
L’amour toujours l’amour, joint aux paroles immortelles, c’est apparemment un beau viatique (4) pour atteindre le paradis de la politique publique en faveur des arts et de la culture.
Le jeu des catégories est puissamment évocateur, mais la science du verbe ne s’arrête pas au passé. On aurait pu aussi citer un texte plus récent de militants politiques affirmant avec tout autant d’absence de doute : «nous considérons notre parti comme celui du soutien à la liberté et notamment à la liberté de création, attachés aussi à ce que la liberté des créateurs soit indissociable de celle des publics» (5). À défaut d’amour, on a la liberté pour tous, créateurs et publics, et, sans doute, demain, le rasage gratis en plus! Encore une utopie féconde pour la politique culturelle. Encore une fois, on se laisse guider par la magie du verbe.
On perçoit bien, et elle nous séduit, la générosité gratuite du propos. Elle a permis de construire un dispositif de légitimation publique fait de grandes «valeurs» et de beaux «principes». Mais, ce dispositif ressemble comme une goutte d’eau à ce que François Dubet qualifie de «programme institutionnel» de la modernité. «Dans la mesure où la modernité a aimé se représenter sous la forme d’un projet culturel cohérent, universel et rationnel, elle n’a cessé de construire des programmes institutionnels, des écoles, des églises, des tribunaux, des institutions charitables et scientifiques susceptibles de produire des individus eux aussi universels à côté et “au-dessus” de leurs croyances et de leurs mœurs particulières» (6). On voit immédiatement que l’analyse vaut parfaitement pour l’institution culturelle puisque la politique culturelle a joué cette carte des valeurs universelles, («œuvres capitales de l’humanité», «création de qualité et de haute exigence artistique») posant le citoyen comme «individu- public» des œuvres, qui doit d’abord les assimiler pour pouvoir s’émanciper de son histoire individuelle, nécessairement à rectifier. Le programme institutionnel de la culture, comme les autres, est «de nature magique parce qu’il transforme des valeurs et des principes abstraits, hors du monde, en pratiques et en disciplines qui sont autant de rites... » (7). Tout y est.
Toutefois, à l’heure du déclin de l’institution, les magiciens se font illusionnistes. Leur «grandiloquence», comme dit Urfalino (8), se paye au prix fort. La magie ressemble à une farce ou pire à une entourloupe car la politique culturelle a éliminé le citoyen de la scène des discussions et a limité son horizon à celui du «public», le «plus fidèle» quand tout va bien, «public à conquérir », quand les chiffres se mettent à trop parler. Seule la figure du «public» est pensée comme passage obligé vers l’art, voie de la libération de l’homme (vers sa vraie nature humaine!). La catégorie «citoyen» est, reste et demeure hors propos de la politique culturelle.
Je voudrais aujourd’hui m’arrêter sur cette disparition du citoyen comme catégorie, dans le discours de légitimité de l’action culturelle publique dans une société démocratique et en tirer les conséquences sur les négociations de politique publique qui attendent l’art et la culture.
I. La disparition de la catégorie « citoyen » est au fondement de la politique culturelle
La disparition de la catégorie «citoyen» est un dogme fondateur, qui à ce titre ne se discute jamais. Le fondement était, à l’origine, solidement établi. On le voit nettement dans les propos des collaborateurs de Malraux, tel Gaëtan Picon qui n’hésitait pas, en son temps, à inclure dans la liste des mots magiques du programme institutionnel, en l’occurrence des Maisons de la culture, l’idée de «l’aliénation du peuple». Au moins, on comprenait que le citoyen ordinaire n’avait rien à dire. Rappel des fondements de l’action culturelle de l’Etat pour Gaëtan Picon : «Notre devoir, pour tout dire, est de mettre un terme à l’aliénation de l’individu par rapport à la culture du présent et du passé» (9).
Le mot, plus sorcier que magique, «d’aliénation» a disparu mais la conviction profonde demeure que le citoyen doit renoncer à sa voix propre pour suivre la voie éclairée des arts. Le dogme demeure que l’anti-destin de l’individu est le renoncement à son identité culturelle originaire, à sa parole valide. Dès lors, la politique culturelle a mission noble de forcer le passage pour que l’individu accède au royaume sacré de la culture universelle, en devenant «public».
Évidemment, une telle situation est difficile à assumer dans une démocratie et supposerait au moins que le citoyen ait explicitement abandonné son droit à la reconnaissance de sa culture. Mais aucune législation ne va dans ce sens, le citoyen n’a mandaté personne pour dire sa culture à sa place! Il faut donc que le programme institutionnel ruse et fasse un usage vraiment illusionniste de la langue de bois pour que l’éviction du citoyen n’apparaisse pas ouvertement comme un déni de démocratie, mais, au contraire, passe pour un service qui lui est rendu.
Toutefois, l’exercice est si délicat qu’il y a régulièrement des dérapages sous forme d’aveux! Parmi tous les exemples possibles, je vais prendre deux textes officiels de la démocratie, la «LOLF» et la «Charte», qui, par la maladresse involontaire de leur formulation, obligent à questionner le dogme de la métamorphose du citoyen en public, et, par là, le fondement du programme institutionnel de la politique culturelle.
A - Une LOLF prétentieuse, plus bête que méchante
Le premier exemple se lit dans une version technocratique fatiguée, mais néanmoins totalement validée par le Parlement Français : la loi de finances pour 2006, en application de la fameuse «LOLF, loi organique relative aux lois de finances qui, depuis 2001, veut mettre en place une gestion plus démocratique et plus performante, au bénéfice de tous : citoyens, usagers du service public, contribuables et agents de l'Etat».
Voyons donc le citoyen «re-LOLFé» à la sauce de la politique culturelle, adoptée par la majorité des députés et dans l’indifférence généralisée.
L’action de l’Etat qu’il faut évaluer comporte une «mission culture» avec trois «programmes» dont un programme d’actions intitulé «transmission des savoirs et démocratisation de la culture». Dans la liste des objectifs, on trouve cette phrase qui illustre parfaitement le dogme et lève le voile de l’illusion: l’objectif est «d’orienter les actions menées par les structures artistiques et culturelles subventionnées par le ministère en direction de territoires où la population est, pour des raisons sociales, culturelles ou géographiques, éloignée de l’offre culturelle».
Essayons de comprendre comment cet énoncé pense les rapports entre la société et ses cultures. Il y a «l’offre culturelle», au singulier, avec article défini, «l’offre culturelle», en majesté. Cette offre unique est celle des structures financées par l’Etat au nom de l’intérêt général. En dehors de cette offre, point de salut culturel.
La société est aussi composée de populations qui ne peuvent pas rencontrer cette offre culturelle parce qu’elles habitent trop loin, (raisons géographiques) ou que leurs ressources sont trop faibles (raisons sociales). Ces citoyens ont besoin de rencontrer l’offre culturelle, mais ne peuvent y parvenir. Il y a attente inassouvie de citoyens ordinaires, sentiment légitime d’injustice et constat d’inégalité d’accès à la culture. On admettra alors que l’amélioration de la performance de l’Etat consiste à réduire les obstacles sociaux et géographiques qui freinent l’accès à cette «offre culturelle».
Par contre, l’énoncé nous dit qu’il y a aussi des citoyens qui n’accèdent pas à «l’offre culturelle» pour des raisons culturelles. Dans l’argumentaire de la performance de l’Etat, ces citoyens sont dans le même sac que les précédents. Ils sont victimes d’inégalités à cause d’un obstacle qui les empêche de rencontrer la «vraie» offre culturelle… Le seul problème est que cet obstacle a un nom : c’est la propre culture du citoyen. Sa culture est la raison culturelle qui l’éloigne de l’offre culturelle! Vive la démocratie : l’identité culturelle du citoyen est la raison qui fait obstacle à la fréquentation de «l’offre culturelle» d’intérêt général! Et aucun député n’a frémi à cet énoncé législatif !
Là où la société de diversité culturelle (et son Etat), aurait dû dire que la pire des inégalités pour un individu est que sa culture soit niée par la société où il a voix de citoyen, le programme de performance de la politique culturelle de l’Etat dit le contraire et fait ressortir de ses limbes la théorie de l’aliénation des masses populaires. Le citoyen n’a pas les bonnes références culturelles puisque les siennes lui interdisent de fréquenter l’offre culturelle de qualité, exigeante et excellente. La performance de l’Etat est ainsi de combattre et de vaincre les identités culturelles des citoyens qui n’envisagent pas de partager l’offre culturelle de la politique culturelle!
On voit toute la vérité de cet énoncé : le citoyen ne peut pas, dans ce contexte, être un interlocuteur valable pour les acteurs de la politique culturelle. Il n’a pas de légitimité à s’immiscer dans l’arène des discussions sur les objectifs de la politique culturelle. Il est citoyen sous tutelle dont la culture doit être rectifiée, pour être conforme à l’intérêt général.
La doctrine de l’aliénation du peuple est bien là, qui refait surface sous le drapeau de l’évaluation des politiques publiques dont nous a pourtant dit qu’elle devait conduire à une gestion plus démocratique !
B - La simpliste «Charte des missions de service public pour le spectacle vivant», une tradition de mépris du citoyen
Si j’ai pris l’exemple de la LOLF, sous un ministère de droite, c’est que la vision qu’il contient des rapports entre «culture» et «personnalité individuelle» est exactement la même que celle de la charte des missions de service public de 1998 qui, sous un ministère de gauche, semblait pourtant marquer un progrès dans l’évolution démocratique du programme institutionnel de la culture.
Là encore, l’énoncé général flatte la démocratie et la démarche s’annonce ouverte : «dans une période où les collectivités territoriales assurent de manière croissante leurs responsabilités culturelles, cette charte veut répondre à une demande générale des élus comme des artistes et des responsables culturels d’une parole forte et claire de l’Etat, ouverte au dialogue et au contrat.»
Puisqu’il est question de dialogue et de contrat, on imagine que la charte va aussi faire place au citoyen. On comprend vite qu’il n’en est pas question. Le paragraphe sur la responsabilité sociale des organismes subventionnés donne la clé du mystère de l’évacuation citoyenne. Regardons de près la « magie » manipulatoire des mots. Pour la charte, la société se compose de deux catégories de citoyens : la première regroupe ceux dont la culture les pousse à fréquenter les organismes culturels subventionnés. Ils forment une catégorie qualifiée de «public le plus fidèle». Leur citoyenneté se réduit à aimer le contact avec les œuvres exigeantes et de qualité mais c’est justement l’objectif de la politique culturelle que de faire accéder les individus à ces référentiels culturels. La mission de service public est bien remplie, au sens où l’intérêt général est que chaque citoyen, «public fidèle», forge sa personnalité singulière à l’aune des choix artistiques de qualité, proposés par la politique culturelle, via les organismes subventionnés. Le citoyen acquiert ainsi la maîtrise de sa culture par son acceptation de son statut de «public». Tout va bien et le programme institutionnel, moderne et émancipateur, tient bon sur ses «valeurs» et ses «principes».
Pourtant, on ne peut pas en rester là. La charte reconnaît qu’il y a d’autres citoyens dont les habitudes, disons plus crûment la culture, ne les conduisent pas à fréquenter les organismes culturels missionnés. La charte pourrait se contenter de les laisser tranquilles ; de les plaindre certes, mais de respecter leur liberté (de non-publics)! Mais, comme dans la LOLF, il est clair que cette présence signalée de citoyens absents de la politique culturelle est gênante. Elle ouvre la voie à des critiques déplacées sur l’élitisme de l’action publique. L’intérêt général, dit la charte, demande une forte réaction. Il convient donc que les organismes culturels de service public soient actifs ; leur mission sera de contribuer, «par tous les moyens, à modifier les comportements» de ces citoyens.
Voilà donc des membres de la société qui ne demandent rien, qui n’attendent rien, qui ne râlent pas et sont contents de leurs habitudes, des citoyens ordinaires, en somme, et pourtant il est d’intérêt général que les organismes culturels parviennent à modifier leurs comportements et référentiels culturels. C’est dire que leur culture n’est pas la bonne. Il va falloir que ça change, leur dit la politique culturelle ! Ils sont donc loin d’être des citoyens à part entière que l’on pourrait entendre et écouter, citoyens dont la parole et l’imaginaire pourraient enrichir la politique publique culturelle. Tout au contraire, il est impératif que la politique culturelle se passe d’eux car sa raison d’être est justement de créer les conditions pour que les citoyens ordinaires modifient leurs comportements qui sont autant de mauvaises fréquentations culturelles. Pour préserver les valeurs d’exigence artistique, on ne peut donc pas imaginer un débat public de citoyens. L’aliénation des masses populaires est de retour. LOLF et Charte, même combat! Fumaroli n’est pas loin.
La phrase de référence dans le texte de la Charte est, quand même, un peu alambiquée mais elle vaut d’être lue attentivement car, d’une certaine façon, la clarté des intentions a contourné la vigilance de la langue de bois de ses auteurs : «La responsabilité sociale - Cette responsabilité s’exerce, au-delà des relations que chaque organisme entretient avec le public le plus fidèle, par tous les modes d’action susceptibles de modifier les comportements dans cette partie largement majoritaire de la population qui n’a pas pour habitude la fréquentation volontaire des œuvres d’art.»
Ces citoyens qui sont depuis longtemps qualifiés de «non-publics», sont donc à redresser dans leurs références culturelles. L’ennui c’est qu’ils forment, nous le rappelle ingénument la phrase, la majeure partie de la population !
La montagne à soulever, si elle était réelle, serait bien haute pour une pauvre petite politique culturelle qui pèse à peine 1 % du budget de l’Etat, même avec la complicité des élus à la culture des collectivités qui sont très nombreux à avoir trouvé parfaite la rédaction de cette charte. Sans doute encore, une histoire de fable millénaire où le possible n’est jamais là ; «Grenouille vaniteuse» qui se voit plus grosse que le bœuf dans la version comique, Prométhée ou Sisyphe, dans la version tragique où il faut, chaque matin du monde, reprendre tout à zéro ! Quel beau destin pour la politique culturelle ! Sans doute surtout une illusion collective, car en 1998 on sait depuis longtemps que la conquête de nouveaux publics est une ligne d’horizon empirique, qui recule au fur et à mesure que l’on essaye de s’en approcher (j’en connais pourtant qui y croit encore!).
Ainsi, du programme institutionnel, décrit par la charte ou par la LOLF, il ne reste que l’intention : permettre aux individus qui le veulent de dépasser leur histoire particulière pour s’imprégner de l’histoire des valeurs culturelles universelles. C’est beau comme l’amour mais, dans la pratique d’un système complexe de négociations entre acteurs de tout poil, c’est une magie d’apprenti sorcier car, dans ce programme institutionnel de la culture, le citoyen est « incapable » de parole valide. Citoyen calmé en « public » ou citoyen majoritaire à redresser, la situation n’est guère prometteuse pour cette politique publique qui perçoit bien qu’elle traverse une crise et qui croit encore qu’il s’agit d’argent. Or, le programme institutionnel ne peut plus jouer la carte de la sanctuarisation. Qu’il le veuille ou non, il ne peut pas s’enfermer dans ses seules valeurs et ses uniques principes, alors que l’idée même de « politique publique » est partout interrogée. Il lui faut bien affronter l’arène de la négociation quotidienne, en argumentant à coup d’évaluation partagée. Ainsi, dans ces moments où la triste réalité du quotidien l’emporte sur l’amour de l’universel sans nuage, il faut dire et redire qu’il est bien stupide de prétendre exclure le citoyen de la négociation sur la légitimité de la politique publique liée à la culture. Il faut se libérer de cette confusion néfaste du programme institutionnel pour lequel le bon citoyen est public, et seulement public, et la majorité de la population, de pauvres gens ordinaires aux mauvaises habitudes. Il faut maintenant mettre le citoyen au centre de la négociation. II- Le citoyen au cœur de l’action culturelle publique, un risque à courir ! La prise de conscience du vide citoyen est ancienne. Les lecteurs attentifs de «L’action culturelle dans la cité» de Francis Jeanson (10) ou de « la Culture au pluriel » de De Certeau (11) le savent bien. D’ailleurs, les tentatives de mettre en œuvre des politiques de développement culturel n’ont pas manqué. Toutefois, l’espoir du « développement culturel » est terni par son absence de dimension politique. Le citoyen semble être au cœur. On le chérit, mais sa parole est sans poids. C’est l’entourloupe de l’approche par la diversité des pratiques culturelles, qui n’est qu’une tentative, naïve ou hypocrite, je ne sais, de conserver le passé sans se faire déborder par le présent.
A- La diversité des pratiques comme fausse entrée en scène du citoyen ordinaire
Le « développement culturel » reste pour beaucoup d’acteurs la solution pour la politique culturelle. Il a en tout cas engendré un puissant militantisme qu’il ne faudrait pas nier. On connaît tous les efforts difficiles conduits pour développer les actions culturelles dans la politique de la ville ou dans l’aménagement des territoires ruraux.
Avec le « développement culturel », la politique culturelle, en particulier des collectivités territoriales, pouvait croire avoir dépassé le stade de l’élitisme simplet de la culture universelle. En reconnaissant la diversité des pratiques culturelles, sans céder sur le maintien au sein de la politique publique de l’exigence artistique, le développement culturel faisait « harmonie », là ou sourdait la tension entre le peuple à émanciper et l’élite. Le modèle moderne de l’institution était, ainsi, préservé puisque l’individu était reconnu dans son passé mais, grâce au choix des références artistiques communes à l’humanité que lui propose l’institution, il accédait à une meilleure maîtrise de son destin. Avec le « développement culturel », il s’agit bien là encore d’émancipation. Comme nous le rappelle François Dubet : « le programme institutionnel repose sur la résolution d’un paradoxe fondamental. Dans le même mouvement, il socialise l’individu et prétend le constituer en sujet…C’est là la véritable magie du programme institutionnel qui produit un individu autonome, c’est-à-dire un acteur conforme aux normes aux règles sociales et un sujet maître de lui-même, un individu dont le “Je” réflexif ne peut jamais se confondre totalement avec son Moi social» (12).
Cet espoir de tenir les deux bouts de la chaîne - autonomiser l’individu en le socialisant - se retrouve clairement par exemple dans une politique municipale comme celle de Nantes. «Vivre ensemble, c’est partager des valeurs communes qui doivent pouvoir s’exprimer dans la diversité culturelle. Il est dès lors de notre responsabilité de soutenir et veiller au respect de la diversité des pratiques et des univers culturels, tout en rendant accessible au plus grand nombre ce que Malraux appelait “les œuvres capitales de l’Humanité”. C’est le choix que nous avons fait à Nantes» (13).
Le programme institutionnel du développement culturel affiche ainsi son intention de résoudre les contradictions via cette voie émancipatrice : la politique publique reconnaît les pratiques culturelles de l’individu mais elle offre à chacun des possibilités de dépasser son histoire (singulière et territorialisée) en associant sa pratique contingente aux valeurs de l’artistique qui, on le rappelle, sont des valeurs supérieures de l’humain (universelles et en plus dé-territorialisées).
On retrouve cette espérance de la réconciliation dans les réflexions sur «l’interculturel » que propose par exemple Emmanuel Négrier. Diversité des pratiques (culturelles) et démocratisation (des valeurs de l’art) peuvent vivre ensemble dans la politique publique.
On lit ainsi : « Les opérations qui sont aujourd’hui présentées sous l’angle interculturel (Saez 2002) opposé à l’élitisme de la politique culturelle d’un côté et au multiculturalisme de l’autre montrent à l’évidence qu’il n’est pas besoin de promouvoir la diversité culturelle comme critère pour lui donner droit de cité dans l’action publique. Le dialogue, sous forme d’atelier entre Nordine Berkani (graffeur) et salah Al-Moussawy (calligraphe) montre toute la richesse d’une démarche de création fondée sur l’échange entre un art, la calligraphie, et une expression urbaine, le graff. Le résultat d’un tel échange est une création qui transfigure l’origine ethnique parce qu’elle révèle une exigence artistique qui n’a rien à envier aux canons officiels de la politique française de soutien aux arts plastiques» (14).
La diversité culturelle serait donc déjà en place dans la politique culturelle, réconciliant « art » et « pratique », « peuple » et « élite », « exigence humaine » et « liberté individuelle ». Vive le développement culturel, Vive la politique culturelle interculturelle capable d’un tel tour de force! Toutefois, cette réconciliation est-elle l’avenir du programme institutionnel ou son dernier habit de magicien?
En fait, la valeur « exigence artistique » continue d’être posée comme émancipatrice par nature et le principe demeure que c’est au sein de la politique publique que doivent être choisies les valeurs artistiques communes.
Or, cette certitude n’est jamais mise en débat. Elle est donnée et non négociable. La question de l’excellence artistique et de ses vertus émancipatrices est une affaire d’experts. Elle n’est pas discutable hors du secret de l’expertise. Il est inconcevable qu’elle puisse être renvoyée au débat citoyen. Que viendrait d’ailleurs faire le citoyen dans cette affaire des valeurs des arts ? Populisme, démagogie?
Le problème du jour est que le principe du choix des valeurs artistiques au sein de la politique publique ne tient plus la rampe dès que la politique culturelle étend son champ d’action au-delà des œuvres capitales de l’humanité.
En effet, en offrant une place aux pratiques culturelles, en donnant des moyens d’existence concrète à la « diversité culturelle », l’institution ouvre la voie à la discussion : Pourquoi ne serai-je qu’un « pratiquant » de cultures sans valeur artistique (le graff comme expression urbaine et pas plus, dans l’exemple cité d’E. Négrier) ? Pourquoi aurai-je la possibilité de faire un atelier de « culture » sans avoir le droit à une parole citoyenne sur la valeur artistique qu’elle porte ? Pourquoi voulez vous que je ne sois qu’un « public » de valeurs artistiques choisies sans moi, on ne sait où ? D’où tenez vous le pouvoir de détenir cette valeur des arts, sommet de l’humain, quand je ne serai qu’un individu enfermé dans un passé médiocre, réduit à la contingence d’une pratique culturelle formatée par mon histoire?
Ce questionnement est l’enfant de la diversité culturelle, qui devient alors le mot magique de trop, celui qui annonce le déclin de l’institution. Le débat sur la diversité culturelle ne porte pas sur la possibilité empirique de pratiquer « sa » culture. Il n’a de sens que s’il porte sur le droit à la parole dans le débat citoyen, pour négocier valeurs et pratiques au sein du vivre ensemble. La politique culturelle entend alors avec terreur les mots de « co-construction », de «co-élaboration» de l’intérêt général et se demande bien ce qu’ils veulent dire. Ils choquent trop le dogme que, dans les fondements de la politique culturelle, les « valeurs » de l’art, moteur de l’émancipation des individus, ne sont pas établies par les individus eux-mêmes, fussent-ils transformés en citoyens par une démocratie un peu trop laxiste!
Ainsi « diversité culturelle » fait bien voir les limites du programme institutionnel de la politique culturelle. La reconnaissance des pratiques culturelles des individus ne peut pas se réduire à une sympathique offre publique pour « pratiquer », avec des « vrais » artistes associées ! « Diversité culturelle » conduit tout droit à la revendication du sens : « je pratique et je veux en dire le sens ». « Je pratique, donc j’ai droit à dire, à dialoguer, à donner “valeur” pour la société ». « Je ne veux pas seulement bénéficier de lieux de pratiques de ma culture, lieux décidés par d’autres ; je veux co-construire tenants et aboutissants et même m’engager à rendre compte ». « Je veux être citoyen reconnu comme négociateur de culture dans les phases de préparation de la décision publique ; je veux être un citoyen à part entière qui contribue au compromis sur les valeurs communes ». La « diversité culturelle » n’est plus la carte de l’illusionniste faite pour calmer les praticiens remuants (et en général fort bruyants). Elle n’est plus la question empirique du faire mais celle du droit à sa propre culture. Elle est d’abord une question d’Etat de droit dans une société de négociation entre citoyens.
B- La diversité culturelle comme état de droit : le droit culturel et ses contrats
Avec cette affirmation que la diversité culturelle est d’abord un enjeu d’état de droit, la politique culturelle (Etat, collectivités et FNCC réunis) s’en trouve totalement tourneboulée puisque toutes ces valeurs fondatrices (dont la valeur d’émancipation par l’art choisi par les pairs) deviennent «enjeux de débats citoyens », sources de discussions au sein de dispositifs de compromis sur les valeurs et la pertinence des actions publiques culturelles et artistiques. On croit rêver ! Le magicien n’était qu’un illusionniste.
Puisque dans cette rencontre, il est question de « catégories », donnons celles qui devront accompagner une politique culturelle de diversité bien compris : la catégorie de référence sera celle du « droit culturel »15 permettant d’établir des contrats culturels, comme dispositifs d’Etat de droit, opposables aux tiers.
Contrat, donc volonté libre de contracter. Il est temps que la politique culturelle renonce à sa désastreuse intention de conquérir des publics qui ne lui demandent rien. Il est temps qu’elle renonce à partir en croisade pour modifier leurs comportements hérétiques. Elle ferait mieux de penser le type de « contrat » qu’elle peut négocier avec ceux des citoyens qui sont demandeurs d’un soutien public, en tant que sujet libre, doté d’un universel droit culturel. Si cette catégorie du « contrat » est invisible dans le programme institutionnel culturel, même dans sa version interculturelle, elle est, par contre, au centre de la société de « diversité culturelle ».
Voici les quatre contrats à concevoir qui formeront les cadres de négociation de la politique culturelle publique.
- Premier contrat : le cont rat d’émancipation culturelle ou contrat personnalisé d’initiat ives culturelles. Le point de départ est le droit du citoyen à pratiquer sa culture. Pour une grande part, la société contemporaine apporte une réponse massive, par le biais du marché généralisé, à ce droit de choisir. On le sait bien, le contrat commercial est déjà une réponse à l’accès à la culture (16).
Mais la société de diversité considère que le marché est loin d’être parfait dans ce rôle de protecteur des identités culturelles. Il revient à l’Etat de droit de définir les lieux, les procédures, les acteurs qui donneront légitimité à des interventions publiques, en compensation des imperfections du marché.
Le remplacement du « public le plus fidèle » par le « citoyen » ne permet pas de dessiner le ciel étoilé de l’illusion libératrice de la culture universelle. C’est plutôt une arène aux combattants aguerris qui s’esquisse. L’état de droit devra donc fixer les règles d’entrée et de sortie en politique culturelle. Une telle négociation fondée sur la revendication de chaque identité culturelle ne se contentera plus de magie. Elle fixera des modalités de compromis entre les intérêts divergents. On peut penser, en tout cas, espérer, qu’elle aboutira à des contrats d’intervention publique où l’heureux bénéficiaire devra expliquer, argumenter avec ses mots, rendre compte, en somme, aux autres citoyens des avantages qu’il a retirés de ce parcours culturel.
Ce contrat avec engagement est inconnu des bénéficiaires de la politique culturelle actuelle. Si on demande au public d’être le plus fidèle, on accordera que l’Etat de droit, même dans sa version LOLF ou Cour des Comptes, ne demande aucune contrepartie. En revanche, avec la société de diversité culturelle, le droit à entrer dans la négociation sur la base de son identité culturelle vaut aussi obligation de rendre compte des bénéfices retirés de l’intervention publique.
Ce contrat culturel de la politique publique est donc fait de droit et de devoir. Sur quoi peut-il porter ? Il n’est pas contrat de consommation, par hypothèse puisque le marché y pourvoit. Il est contrat négocié d’émancipation culturelle au sens où chaque acteur, grâce à l’intervention publique, parvient à une meilleure maîtrise de son propre parcours. Loin de la consommation passive, le contrat d’émancipation culturelle met en scène l’individu comme acteur, dans le faire et dans le droit, pour qu’il puisse réaliser, grâce à l’aide publique, le trajet culturel qu’il a négocié. Pour ceux qui auraient l’oreille fine, ils doivent entendre, ici, développement de centres de ressources, missions d’accompagnement de projets, apprentissage des langues et formes artistiques et autres perspectives afin de donner aux identités culturelles une dimension « variée, plurielle et dynamique ».
Reste aux décideurs publics, dans la négociation citoyenne, à déterminer qui négociera avec le citoyen le « bon » parcours culturel qui méritera un soutien public ? Qui signera au nom du décideur public les contrats dessinant les parcours d’émancipation culturelle ? La discussion sera longue car l’habitude prise de considérer le citoyen comme un non-public ne disparaîtra pas de sitôt. Il faudra bien, en particulier au niveau local, déboucher sur l’idée de missions de service public confiant à des équipes professionnelles le soin de négocier avec les individus des contrats personnalisés qui leur permettent de prendre des initiatives. Il faudra bien, en quelque sorte, inventer collectivement un dispositif donnant corps à des « contrats personnalisés d’initiatives culturelles ».
Après tout, d’autres politiques publiques savent le faire pour la formation ou l’accompagnement social… Pourquoi pas pour donner du sens et de la pratique au « droit culturel », qui en aura bien besoin ! Sans doute, dans le cadre par exemple de « l’agenda 21 culture », peut-on engager quelques tentatives citoyennes en posant d’emblée l’individu comme sujet de droit (à sa culture)?
- Le deuxième contrat concerne l ’expérimentation et la confrontation artistiques. Le contrat est, ici, aussi une catégorie forte. En effet, si la société de diversité culturelle pose l’individu et son identité culturelle comme un impératif du vivre ensemble, elle n’est pas dupe. Son devenir suppose que les identités ne soient pas figées. L’Etat de droit doit donc prendre le risque de soutenir les dynamiques d’innovation, de créativité, de mise en expérimentation de nouveaux signes, aussi peu décodables qu’ils puissent paraître à l’instant. La société de diversité culturelle doit, dans un même mouvement, organiser le dialogue des citoyens, rechercher l’harmonie des identités culturelles dans l’espace public, tout en favorisant la confrontation avec de nouvelles représentations du monde, qui, seules, éviteront à la société de se scléroser.
Le droit à l’expérimentation artistique devient impératif à condition que l’Etat de droit organise le débat sur les valeurs artistiques en émergence et leurs rapports avec les valeurs communes. Le droit à l’expérimentation artistique et la liberté de faire qui l’accompagne, se marie avec le droit de débattre, de dialoguer, d’informer, de confronter, de défendre, d’inciter à la reconnaissance des arts en train de se faire. Les médiateurs des valeurs artistiques deviennent l’avenir de la société de diversité culturelle. Autrement formulé, les décideurs publics nourrissent les expérimentateurs artistiques de la possibilité de faire reconnaître dans l’espace public le sens de leurs actions. Ils apportent les moyens publics à la multiplication des débats sur les valeurs, la présence ou non de l’excellence, de l’exigence, de la qualité. En ce sens, ils facilitent les échanges et remplissent la mission première que leur assigne la société de diversité culturelle : l’interpénétration culturelle entre sujets libres. By, by les publics !
Le « contrat d’expérimentation et de confrontation artistiques » affichera donc, dans l’Etat de droit, une solide protection de la liberté du créateur avec pour seule contrepartie non pas l’audimat des publics séduits, mais l’obligation d’être partie prenante au débat, collectif et citoyen, sur les valeurs émancipatrices de « l’art en train de se faire ».
Autant dire que cela nous changera des dispositifs où le décideur public opère les choix de qualité artistique avant de décider de son soutien. Dans la société de diversité culturelle, il se libère de cette absurdité mais investit beaucoup dans l’organisation du débat transparent et, par là, émancipateur, sur la valeur des arts.
- Le troisième contrat touche au partage culturel. Le marché a déjà ses règles. Elles sont puissantes et bien défendues. Elle offrent des opportunités étonnantes pour les biens et services culturels, comme d’ailleurs pour le développement des « arts en train de se faire ». Mais le marché, s’il n’a jamais autant fourni de livres, de disques ou de spectacles, a un défaut majeur. Il limite son critère de pertinence a l’obtention d’un profit maximal.
La société de diversité culturelle a l’intelligence de ne pas nier la puissance du marché ; en revanche, elle rappelle avec force que le marché n’est pas un monstre naturel auquel il faudrait obéir aveuglément et sacrifier chaque matin, au réveil, le meilleur de nos enfants de l’art naissant!
La société de diversité culturelle voudra donc imposer des règles spécifiques pour défendre le droit culturel.
Puisqu’il s’agit de « Vivre ensemble », le contrat de service culturel pourrait très bien ne pas être subordonné à la recherche du profit ; il pourrait fort bien se centrer sur la recherche de plus-value sociale.
En tout cas, le débat citoyen peut conduire à donner toute légitimité aux échanges solidaires entre les identités culturelles. La fourniture de biens et services culturels relèverait alors d’autres règles que celle des échanges pour la maximisation du profit. Choix éthique que le dialogue citoyen peut transformer en choix politique et donc en Etat de droit. S’ouvre alors la voie du contrat de partage culturel qui nécessite que des décisions soient prises pour réguler autrement les marchés que par la règle de la concurrence parfaite.
Les logiques de l’économie sociale et solidaire s’appliqueraient ici fort bien en amenant l’autorité publique à favoriser les soutiens publics indirects aux porteurs de projets culturels (réduction d’impôts de toute sorte et autres formes de contribution volontaire, favorisée par la fiscalité), dès lors que le producteur culturel s’engage à jouer le jeu de la charte éthique liée au contrat de partage culturel.
Le contrat de partage culturel devient ainsi la troisième catégorie de contrat qui, avec le contrat d’émancipation culturelle et le contrat d’expérimentation et de confrontation artistiques, dessine l’avenir de la société de diversité culturelle.
-Il reste évidemment un quatrième contrat , le contrat de coopération. Contrat de coopération entre les acteurs des pays les plus démunis et ceux qui disposent de ressources pour faire avancer leur projet. Les acteurs qui veulent défendre la culture auront à le travailler avec minutie, tant les chausse-trappes sont nombreuses. Le chantier du contrat de coopération dont parle abondamment la « Déclaration universelle sur la diversité culturelle » comme la « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles » est à lancer au niveau de la société civile en terme de co-développement, sans répéter les erreurs du passé qui ont trop souvent plombé le sens de la coopération culturelle. Ce n’est pas le chantier le plus facile et les termes de ce contrat sont loin d’être encore bien définis.
Que le citoyen revienne au centre du débat, qu’il supplante le « public » dans les stratégies des décideurs publics. Que la négociation s’engage pour vraiment sortir de la crise, avec l’appui des citoyens ! Le temps des héros magiques est terminé. Les textes de l’introduction à cette rencontre ont épuisé leurs ressources car nul n’a trouvé l’anneau !!! Le temps des hommes pauvres commencent et leur destin sera celui de la négociation qu’ils auront entre eux, si l’Etat de droit le veut bien! Le crépuscule des dieux en somme, ce qui n’impose pas que l’œuvre soit au final sans force émancipatrice ! On le sait depuis Prométhée.
Le temps est à l’Etat de droit, au débat citoyen, pour fixer les règles transparentes de la négociation sur l’émancipation culturelle, l’expérimentation et la confrontation artistiques, le partage culturel, la coopération des acteurs de cultures. Pour la politique culturelle, l’impératif d’un renversement des fondamentaux s’impose et, avec lui, viendra la fin de la malédiction du non-public et de la terreur de l’aliénation culturelle du peuple !
(Communication faite lors de la rencontre internationale "Culture Publique", le 7 juin 2006 au théâtre du Rond Point)
Notes:
(1) Cf. cette phrase magnifique de Malraux, extraite du discours d’inauguration de la maison de la culture d’Amiens : «Il y aura toujours ce moment prodigieux où l’espèce de demi gorille levant les yeux se sentit mystérieusement le frère du ciel étoilé.»
(2) Cf. entretien de Jean Louis Fabiani dans « La lettre culturelle de Nantes », janvier 2006.
(3) Cf. le texte de l’inauguration de la maison de la culture de Bourges et le texte du discours de l’inauguration de la maison de la culture d’Amiens où Malraux dit aussi à propos d’Antigone «peu importe les lois des hommes, il y a aussi les lois non écrites». Voir pages 286 et 302 dans «André Malraux, ministre», la documentation française, 1996.
(4) « Viatique » est aussi, au sens figuré, dans le Littré, « le sacrement de l’eucharistie administré aux malades en danger de mort ».
(5) Cette phrase qui en vaut bien d’autres est extraite d’un article paru dans « Le Monde » du 22 décembre 2005, et signé Anne Hidalgo et Christophe Girard.
(6) François Dubet : Le déclin de l’institution, page 28, ed. Le Seuil, Paris 2002.
(7) Ibidem, page 47.
(8) Voir en particulier : « Après Lang et Malraux, une autre politique culturelle est-elle possible », Esprit, mai 2004.
(9) Gaëtan Picon : La culture et l’Etat, discours de Béthune, 1960, in « Les affaires culturelles au temps de Malraux », La documentation française, 1996, page 353.
(10) Francis Jeanson : « l’action culturelle dans la cité », éditions du Seuil, Paris 1972.
(11) Michel DE Certeau : « La culture au pluriel », Union générale d’édition, 1974. On peut y lire à propos de « politique culturelle » : «il s’agit de savoir si les membres d’une société, aujourd’hui noyés dans l’anonymat de discours qui ne sont pas les leurs, et soumis à des monopoles dont le contrôle leur échappe, trouveront, avec le pouvoir de se situer quelque part dans un jeu de forces avouées, la capacité de s’exprimer.», page 214, seconde édition.
(12) François Dubet, ibidem, page 35.
(13) Éditorial de Jean Marc Ayrault dans « La lettre culturelle de Nantes », 2003.
(14) E. Négrier : Diversité, politique culturelle et multiculturalisme, in Revue de l’Observatoire des politiques culturelles, hiver 2006.
(15) Sur le droit culturel voir les apports de Patrice Meyer Bisch « De l’universalité de droits culturels », Bulletin de l’Observatoire des politiques culturelles, hiver 2006 et le projet de déclaration du groupe de Fribourg sur le droit culturel : www.unifr.ch/iiedh .
(16) Cela n’a pas échappé au rédacteurs de la « charte » qui, la seule fois qu’ils parlent du « citoyen » l’associe au libre choix de sa culture, par conséquent sur le marché puisque, par ailleurs, il est massivement non-public!


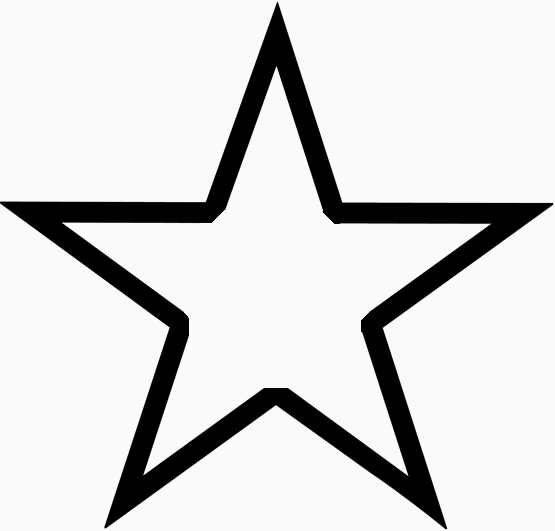
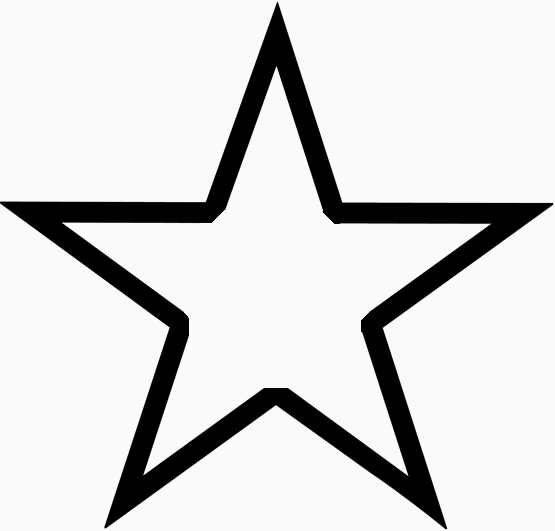


 Actualités
Actualités













