

Humaniser la mondialisation
Source : Le Courrier de l'Unesco
MIREILLE DELMAS-MARTY répond aux questions de Jasmina Šopova
Face à la mondialisation, l’humanisation des systèmes de droit progresse-t-elle ou marque-t-elle le pas ?
À première vue, l’humanisme juridique semble renforcé par la multiplication des instruments juridiques et des instances internationales chargés de contrôler le respect des droits de l’homme, de même que par l’apparition d’un droit humanitaire et l’émergence d’une justice pénale à vocation universelle. Et sur le plan économique, le marché global a pour ambition de créer des emplois et d’accroître la prospérité.
En apparence, donc, tout a l’air d’aller pour le mieux dans le meilleur des mondes… Or, la mondialisation, qui fonctionne comme une loupe grossissante, révèle une série de contradictions et soulève une nuée de questions. Comment concilier le concept de sécurité et le principe de liberté ? Les droits économiques et la protection de l’environnement ?, etc. La mondialisation aggrave même la situation lorsqu’elle dissocie, par exemple, les droits
économiques, déjà globalisés, des droits sociaux qui relèvent des États, euxmêmes affaiblis par les contraintes qu’imposent les marchés financiers. On peut également se demander s’il n’y a pas de contradiction entre l’universalisme affirmé par la Déclaration des droits de l’homme de 1948 et la Convention 2005 de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui qualifie la diversité culturelle de patrimoine commun de l’humanité.
Comment ces contradictions se traduisent-elles dans les faits ?
L’une des contradictions les plus fortes concerne les migrations. Les frontières sont ouvertes aux marchandises et aux capitaux, mais fermées aux êtres humains. La tendance est même au durcissement du contrôle et de la répression dans bon nombre de pays, au point d’aboutir à une sorte d’amalgame entre immigration et criminalité. Or, ces mêmes pays, en imposant l’ouverture des frontières au marché global, déséquilibrent les marchés locaux et incitent les populations à partir. En somme, ce sont les mêmes acteurs qui fabriquent l’immigration et qui, simultanément, la répriment.
Par ailleurs, la dissociation entre droits économiques et droits sociaux limite la croissance aux profits économiques et financiers, sans empêcher l’aggravation de la précarité et des exclusions sociales, qu’il s’agisse du chômage ou de la grande pauvreté. L’écart s’accroît entre les revenus les plus élevés et les plus faibles au même rythme que la prospérité progresse.
Enfin, l’exploitation des ressources naturelles, un secteur où les entreprises multinationales jouent souvent un rôle
moteur, est à l’origine d’un nombre grandissant de conflits armés dans le monde, notamment en Afrique et en Amérique latine. C’est ainsi que les crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression persistent, malgré la création d’une Cour pénale internationale (CPI)1. Certes, son entrée en vigueur est relativement récente (2002), mais les raisons sont aussi d’ordre structurel : le statut de la CPI ne prévoit pas la responsabilité des personnes morales2, et les entreprises demeurent impunies en cas d’infraction. Le constat affaiblit le rôle dissuasif qui était pourtant inscrit dans ce statut (à la différence des tribunaux ad hoc3 qui jugent des crimes déjà commis, la CPI siège en permanence).
Qu’en est-il des contradictions entre les droits économiques et les droits de l’environnement ?
L’impératif de développement et de compétitivité dissuade les États de s’engager dans la protection de l’environnement. Comment, dès lors, protéger la planète contre les effets négatifs du changement climatique, l’érosion de la biodiversité ou la pollution des eaux ? (voir pp. 34-35) Tandis que les pays industriels conditionnent leur engagement à celui des pays en développement ou émergents, ces derniers invoquent l’équité historique : dans la mesure où les pays industriels sont à l’origine de la pollution de la planète, ils doivent à présent participer à l’effort général pour préserver l’environnement, tout en permettant aux autres de se développer. L’expression « développement durable » est supposée organiser une synergie entre les droits économiques et les droits de l’environnement, mais tant que l’on n’y aura pas intégré la notion de développement équitable, il s’agira d’une synergie « en trompe-l’oeil ».
En modifiant la condition humaine, les nouvelles technologies n’ajoutent-elles pas aux paradoxes ?
Les technologies ont toujours été « nouvelles ». Ce qui a changé, c’est l’accélération des innovations. Ainsi, en matière de technologies numériques, le droit français ne parvient pas à suivre le rythme. À peine le Conseil constitutionnel a-t-il statué sur une loi que la pratique s’est déjà transformée et échappe à la législation !
Les technologies de l’information pourraient contribuer à renforcer la démocratie, comme on l’a vu récemment dans certains pays arabes, mais elles favorisent, en parallèle, l’instauration d’une société de surveillance.
L’ambivalence est tout aussi forte dans le domaine des biotechnologies qui permettent tout à la fois de lutter contre la stérilité, grâce à l’assistance médicale à la procréation, et de faire des tris d’embryons, via le diagnostic préimplantatoire, en se rapprochant ainsi de l’eugénisme pourtant considéré comme un crime.
La généralisation de telles pratiques réduirait la loterie génétique, donc la part du hasard et la diversité biologique des êtres humains. D’où ce paradoxe : au nom des libertés individuelles (être maître de son corps et de sa descendance), nos sociétés prennent le risque de provoquer une sorte de formatage de l’espèce humaine. (voir pp. 39-40)
Autre paradoxe : plus nous dépendons des technologies numériques, plus nous perdons de notre autonomie, alors que nous fabriquons des robots de plus en plus autonomes. Les robots peuvent aider des personnes âgées ou malades et contribuer au bienêtre social. Mais aux États-Unis comme en France, des programmes ont été lancés pour mettre au point des robots capables de remplacer des soldats en chair et en os, de faire des « guerres propres » et d’atteindre des cibles sans toucher les populations civiles. À cet effet, il faudrait insérer des règles éthiques dans le programme du robot, avec tous les risques d’erreur que comporte l’interprétation d’un tel programme. Les choix éthiques les plus importants sont d’une extrême subtilité qu’il est difficile de prévoir à l’avance avec une rigueur mathématique.
Tous ces exemples mettent en évidence un processus de déshumanisation. Que peut faire le droit ?
Son rôle est difficile car, dans un monde en transformation accélérée, il ne s’agit pas de revenir à un concept statique,
défini comme « humanisme juridique », mais de mettre en place une dynamique, c’est-à-dire des processus d’humanisation. Plutôt que de réaffirmer des principes, il faut tenter d’inverser, dans les pratiques, le mouvement de déshumanisation. Seule une application effective des droits de l’homme évitera les dérives du totalitarisme politique, comme celles du totalitarisme du marché, notamment du marché financier.
De quels moyens dispose-t-il ?
Le droit n’offre pas une réponse à chacun des défis que j’ai évoqués. Mais certains processus juridiques en cours offrent des débuts de réponses pour humaniser la mondialisation.
Par exemple, construire une citoyenneté à plusieurs niveaux : c’est un processus lent et difficile, mais il répond aux problèmes des migrations comme à ceux liés à l’environnement.
Certes, la citoyenneté du monde est un vieux rêve qui existe depuis l’Antiquité. Plus près de nous, Emmanuel Kant a rêvé
de la paix perpétuelle entre les nations4 dans l’Allemagne de la fin du 18e siècle, de même qu’en Chine, Kang Youwei5 a rêvé de l’âge de la grande paix du monde à la fin du 19e siècle.
Ce « rêve des deux K » pourrait se réaliser progressivement. On observe déjà que la création d’une citoyenneté européenne, sans faire disparaître les citoyennetés nationales, tend à les compléter. À l’échelle planétaire, le Forum
mondial sur la migration et le développement6 met petit à petit en place une approche globale intégrant le souci d’humanisation aux contraintes économiques. En attendant que les pays d’émigration se décident à ratifier la convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants (signée en 1990 !), on peut y voir l’ébauche d’un processus de reconnaissance de certains droits qui préfigurent une future citoyenneté du monde.
C’est en regardant l’avenir, face aux risques globaux, que nous commençons à prendre conscience de l’humanité comme une communauté de destin. Mais seule la référence à une histoire de l’humanité, que l’UNESCO peut contribuer à établir et diffuser, permettra de construire une citoyenneté interculturelle – inter et non multiculturelle, car il ne suffit pas de juxtaposer des cultures, mais de viser l’objectif ambitieux d’une humanisation réciproque. (voir pp. 14-16)
Est-il utopique d’imaginer une gouvernance mondiale fondée sur des principes humanistes ?
À l’heure actuelle, c’est encore une utopie. L’hétérogénéité de la puissance, partagée entre quelques États et les grandes entreprises multinationales, rend l’organisation d’une gouvernance mondiale extrêmement difficile. Il faudrait parvenir, en cas de violation des droits de l’homme, à responsabiliser tous les titulaires de pouvoir. Pour les États, un tel processus commence à fonctionner au sein du Conseil de l’Europe (avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la cour de Strasbourg), également en Amérique latine (la Convention interaméricaine relative des droits de l’homme n’ayant pas été ratifiée par le Canada et les États-Unis) et depuis peu en Afrique (avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples). À défaut de Cour mondiale des droits de l’homme, des mécanismes moins contraignants se mettent en place, mais ils sont insuffisants et dispersés.
Et s’agissant des entreprises multinationales ?
La responsabilité dite « sociale » se limite à quelques îlots de hard law7 dans un océan de soft law (principes directeurs, codes de conduite, etc). En cas de violations graves, les pays où les firmes multinationales sont implantées n’ont en général ni les moyens ni la volonté de les poursuivre, car leur souci est d’éviter la perte d’emplois. Quant aux pays d’origine, ils sont rarement compétents (et ne souhaitent pas l’être) pour poursuivre des faits commis à l’étranger contre des victimes étrangères.
Certes un très vieux texte (Alien Tort Claims Act, 1789), qui permet aux juridictions fédérales des États-Unis de juger toute personne ayant commis des violations des droits de l’homme, même à l’étranger et à l’encontre d’étrangers, a été invoqué ces dernières années contre des multinationales. Mais les condamnations sont rares.
Je ne suis d’ailleurs pas favorable à ce principe de « compétence universelle » en tant qu’il transforme les superpuissances en juges du monde. Nous avons plutôt besoin, à défaut de cour mondiale, d’une convention internationale qui, en cas de violations des droits de l’homme commises par des multinationales, attribuerait compétence au pays d’origine et, si ce dernier ne juge pas l’affaire, donnerait les moyens de mener le procès (personnel, logistique) au pays d’implantation.
La Cour pénale internationale ne peutelle être saisie ?
Même si on élargissait sa compétence aux personnes morales, les multinationales ne seraient jugées que pour les crimes les plus graves : génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre… En revanche, la Cour peut poursuivre un chef d’État en exercice, ce qui représente une révolution politique et juridique. Malheureusement, sans police à sa disposition, elle n’a pas les moyens d’exécuter ses mandats d’arrêt. Pour le moment, elle fait appel à la coopération des États, ainsi qu’aux forces de l’ONU et de l’OTAN, avec des résultats très insuffisants. Le problème de l’articulation entre la justice et la force reste à organiser à l’échelle mondiale.
Et l’articulation entre la justice et la paix ?
D’ordinaire, on considère qu’il n’y a pas de paix durable si justice n’a pas été rendue au préalable. Mais des exemples
comme la Commission sud-africaine « Vérité et Réconciliation » montrent que l’on peut rétablir la paix sans juger nécessairement tous les criminels, mais seulement ceux qui refusent de reconnaître leur culpabilité. Sur ce plan, le monde occidental a sans doute à apprendre de l’Afrique pour éviter ce que j’appelle le « fondamentalisme juridique », c’est-à-dire, comme en religion, la clôture et le rejet de la pluralité des interprétations. L’exigence de justice doit être combinée avec le besoin de paix. Et le refus de l’impunité ne doit pas revêtir un caractère absolu.
Que pensez-vous du problème de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, laquelle est déjà inscrite dans la Charte française de l’environnement ?
Des références aux générations futures se mettent en place, en effet, dans les textes, notamment cette charte qui a valeur constitutionnelle. Dans la pratique, il reste à faire preuve d’imagination pour faire entrer les générations futures dans le champ juridique. Qui peut représenter leurs intérêts? De quoi, et pendant combien de temps, est-on responsable ?
Comment indemniser ceux qui ne sont pas nés ?, etc.
Pour ma part, j’hésite à parler des « droits » des générations futures, de même que des « droits » de la nature ou des animaux, parce qu’il n’y a pas de réciprocité possible. En revanche, en tant qu’êtres responsables, les humains ont des devoirs vis-à-vis de leurs futurs descendants, comme vis-à-vis des vivants non humains.
Il faut toutefois être prudent, car pendant longtemps la notion des « devoirs de l’homme » a fait partie du discours légitimant l’arbitraire de l’État, alors que l’expression « droits de l’homme », si elle est opposable aux États, permet de poser des limites aux abus de pouvoir, de « raisonner » la raison (ou la déraison) d’État. En revanche, dans les relations sans réciprocité, il faut aussi reconnaître des devoirs. Il reste à trouver le juste équilibre car les devoirs que nous avons à l’égard des générations futures ne doivent pas supprimer les droits des générations présentes.
Les unes comme les autres sont concernées par les dangers venant des innovations technologiques. Vous avez compté ces dangers parmi les défis que doit relever l’humanisme moderne.
On ne peut pas interdire toutes les innovations technologiques. Ce serait absurde puisque l’homme s’est humanisé en les développant et en les mondialisant, à toutes les époques. (voir pp. 32-33) On a mondialisé la roue, puis la brouette, puis la boussole, etc. Mais il faut éviter de considérer que tout ce qui est possible doit être permis (les innovations étant inéluctables, il serait vain de s’y opposer). Il est donc important d’adapter les réponses juridiques aux innovations technologiques.
Encore faut-il restructurer les relations entre acteurs scientifiques et acteurs politiques, entre savoir et pouvoir, car il y a là aussi une lacune dans la gouvernance mondiale. Les États défendent les intérêts nationaux, les entreprises, les intérêts privés, et, à part des organisations internationales dotées de peu de moyens d’action, personne n’est chargé de défendre l’intérêt général. Ce sont les experts qui comblent cette lacune. En principe, ils n’ont pas le pouvoir de décision, mais dans la pratique, ils jouent souvent un rôle clé en ce qui concerne les innovations scientifiques et leurs applications. Si le statut mondial de l’expertise n’existe pas encore, des dispositifs dispersés commencent à garantir l’indépendance et l’impartialité des experts et tentent d’éviter les conflits d’intérêt.
Mais il ne suffit pas d’adapter le droit aux pratiques nées des nouvelles technologies, voire d’anticiper sur les risques à venir…
Effectivement. Il faut aussi tenir compte des ambivalences. Les technologies engendrent des effets déshumanisants tels que l’émergence d’une société de surveillance ou le formatage de l’espèce, auxquels il convient de résister pour ne pas perdre les acquis des humanisations au motif que la mondialisation effacerait l’histoire de chaque peuple.
Quelles seraient les composantes de cette communauté humaine de valeurs ?
Elles ne sont pas données d’avance. Elles émergent progressivement par l’humanisation réciproque, au croisement des cultures. Même la notion de dignité humaine, que l’on imagine définie une fois pour toutes, reste à consolider, notamment en ce qui concerne le statut des femmes.
Néanmoins, la liste des crimes contre l’humanité ou des interdits de la torture et des traitements inhumains ou dégradants laisse implicitement apparaître des composantes communes de l’humanité, comme la singularité de chaque être humain et son égale appartenance à la communauté humaine. Et les risques créés par les nouvelles technologies suggèrent d’ajouter une troisième composante : l’indétermination. L’être humain n’est pas déterminé d’avance, c’est sa part de liberté et le fondement de sa responsabilité.
C’est par référence à ces trois composantes que le droit pourra jouer son véritable rôle : résister, responsabiliser, anticiper. Résister à la déshumanisation, responsabiliser les titulaires d’un pouvoir global, anticiper les risques à venir. On peut y voir l’instrument d’un nouvel humanisme qui ne serait pas fixé comme un dogme mais conçu comme une dynamique d’humanisation des pratiques.
---
1. Créée par la Convention de Rome du 17 juillet 1998, la Cour pénale internationale, entrée en fonction en juillet 2002, est la première juridiction permanente destinée à juger, selon son préambule, « les responsables des crimes qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine ».
2. Une personne morale est une entité, autre qu’une personne physique, dotée d’une existence juridique et ayant, à ce titre, des droits et des obligations.
3. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), créé en 1993, et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), créé en 1994.
4. Dans un texte de 1795, Zum Ewigen Frieden (Vers la Paix perpétuelle), Kant synthétise le débat des Lumières sur la paix et l’idée fédérale.
5. KANG Youwei, Datong Shu, trad. L.G Thompson, The one world Philosophy of K’angYu-wei, Londres, 1958.
6. Le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), qui a tenu sa première réunion à Bruxelles en 2007, constitue une plateforme d’échanges de pratiques et d’expériences visant à définir des moyens qui permettent de tirer le meilleur parti des migrations internationales pour le développement et à réduire leurs effets négatifs.
7. La hard law (droit dur) désigne la forme traditionnelle du droit, notamment la loi, (précise, obligatoire, sanctionnée). La soft law peut se traduire par droit souple car elle désigne une norme tantôt imprécise (le flou), tantôt sans valeur obligatoire (le mou), tantôt sans sanction (le doux).
Élue membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques en 2007, Mireille Delmas-Marty (France) occupe depuis 2002 la chaire « Études juridiques comparatives et internationalisation du droit » au Collège de France où son cours questionne l’humanisation des systèmes de droit à un moment où celle-ci semble plus que jamais nécessaire. Elle est notamment l’auteur de : Les forces imaginantes du droit, oeuvre monumentale en plusieurs volumes : Le relatif et l’universel, Le pluralisme ordonné, La refondation des pouvoirs, Vers une communauté de valeurs ? (Seuil, 2004-2011). Elle a également publié en 2010 Libertés et sureté dans un monde dangereux et prépare pour 2012 la publication de son dernier cours, Sens et non-sens de l’humanisme juridique.
---
Liens :
Le courrier de l'UNESCO "L'humanisme, une idée neuve" (octobre - décembre 2011)


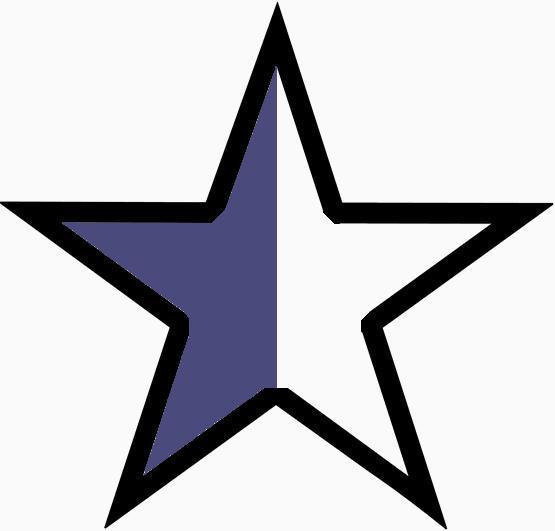
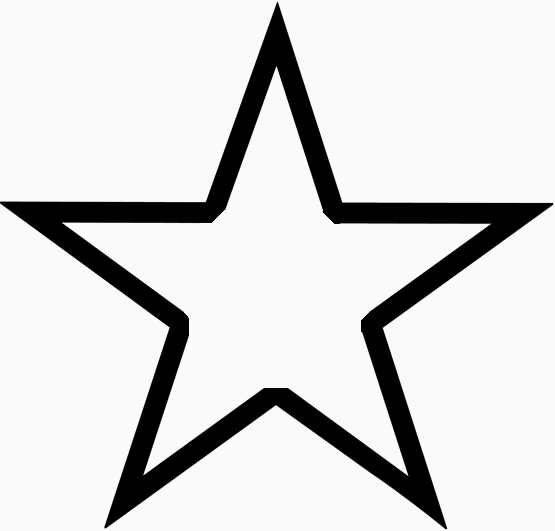


 Actualités
Actualités



