

Gouvernance : un concept ambigu
Source : Georges Navet
En un premier sens, qui se veut précis et quasi technique, le mot de «gouvernance» désigne une manière particulière de gouverner. En un second sens, plus large et plus vague, il tend à désigner la manière de gouverner en général. Toutefois, dans ce dernier cas, c’est souvent à l’adjectif accompagnateur que revient la charge de faire signe vers le premier sens, ou vers quelque chose qui s’en rapprocherait. Lorsque l’on parle par exemple de «nouvelle» gouvernance, on l’oppose à une «ancienne» qui, par définition, se met ainsi à relever du même concept. Il est pourtant sous-entendu que l’«ancienne» était une «malgouvernance»: une gouvernance qui n’était pas adéquate à son concept.
Nous sommes de la sorte reconduits au premier sens – qu’il s’agit donc de tenter de cerner. Il est probable que c’est par le biais de la gouvernance dite «globale» que le terme est entré dans le vocabulaire français (ou plutôt y est rentré, puisque, sous l’Ancien régime, il désignait des juridictions royales). Quoi qu’il en soit, c’est-à-dire toute question d’origine écartée, le biais mentionné fournit le meilleur angle d’approche, comme si, en se dilatant à l’échelle planétaire, la notion rendait plus visibles les manières de comprendre et d’opérer qui la caractérisent et qui restent cependant analogues à des échelles plus réduites.
Quel est l’axe commun aux divers auteurs qui, à la fin des années 1980 ou au début des années 1990, «lancent» le concept de gouvernance globale? La coïncidence avec la fin de l’opposition entre Est et Ouest qui jusque là constituait la toile de fond des rapports internationaux n’a sans aucun doute rien de fortuit. Les auteurs mentionnés partent d’un double constat: 1/ un ordre (en l’occurrence «global») est nécessaire; 2/ les gouvernements ne suffisent pas à l’assurer. Il ne s’agit pas pour autant de créer un nouvel ordre ex nihilo. Les auteurs ne se présentent surtout pas comme des utopistes, ni même pour des gens qui voudraient quelque peu bousculer ou forcer la réalité des choses. Ils se présentent plutôt comme des analystes ou des observateurs qui repèrent des lignes de force, des tendances de fond qui sont déjà à l’œuvre. En d’autres termes, ils prétendent renvoyer au monde l’image de ce qu’il est vraiment (par le détour de ce qu’on appelle aujourd’hui la «réflexibilité»). Mais ils ne s’arrêtent pas là. Ces lignes de force, ces tendances de fond, il faut, sinon les institutionnaliser, du moins les reconnaître – les faire passer de la réflexibilité à la reconnaissance. De descriptif, le discours se fait prescriptif, à ceci près que la prescription est censée provenir, non des auteurs eux-mêmes – qui d’observateurs seraient devenus acteurs – mais de la réalité et de son devenir. Une politique, ou du moins une manière de gouverner, est suggérée de la sorte, qui consisterait moins à proposer une orientation ou une direction, qu’à percevoir les forces porteuses de ce devenir et à en faciliter l’émergence, l’expression et la rencontre.
De méthode d’analyse, la gouvernance se mue insensiblement en méthode de gouvernement. Si les gouvernements, pris au sens courant du terme, ne suffisent pas ou plus à assurer un ordre global, quelles autres instances peuvent y contribuer? Les instances, précisément, qui sont en elles-mêmes et par elles-mêmes productrices d’ordre. On entend par gouvernance, au sens le plus dur et le plus net du mot, le mécanisme par lequel une société ou une organisation quelconque secrète des règles de conduite et d’action qui lui permettent de se perpétuer et de s’accroître. La perpétuation signifie la viabilité, l’accroissement y ajoute le dynamisme ininterrompu (le «développement durable», par exemple); les deux prouvent le bien-fondé des règles internes par la réussite qu’elles permettent. Les règles, contrairement à ce qui a lieu pour un État, n’ont pas forcément besoin d’être édictées par un législateur; elles n’ont même pas forcément besoin d’être conscientes, il suffit qu’elles informent les conduites et les actions en les menant à la réussite dans l’ordre d’activité considéré.
Idéalement, l’échec devrait suffire comme sanction: la gouvernance idéale s’impose par elle-même, par la force des choses, de façon en tout cas impersonnelle. Pratiquement, on accordera la possibilité qu’existe une autorité de contrôle, à la condition qu’elle se contente de faire respecter les règles spontanément issues de la société ou de l’organisation, sans prétendre jamais en imposer d’extérieures. La gouvernance est donc, à ce niveau, l’autorégulation ou l’autocontrôle d’une sphère d’activité. Le marché et l’entreprise tels qu’ils sont pensés par le libéralisme, en sont évidemment les modèles.
Qu’est-ce, maintenant, que la gouvernance «globale»? Le concept, à ce niveau, perd de sa dureté et de sa netteté. La gouvernance globale est, ou serait, la multiplicité mouvante et complexe des accords, arrangements ou compromis (les vocabulaires varient), implicites ou explicites, entre les diverses instances (entreprises, sociétés, organisations, États …) ayant fait la preuve de leur viabilité et de leur capacité régulatrice à l’échelle mondiale, – en tant que ces accords, arrangements ou compromis seraient devenus assez routiniers, assez longtemps producteurs d’ordre, pour être considérés à leur tout comme ayant fait leurs preuves.
La gouvernance globale n’exige pas, on le constate, que toutes les instances participantes fonctionnent elles-mêmes selon le principe de la gouvernance prise stricto sensu – la simple capacité à créer de l’ordre prend ici le pas sur la capacité à créer un certain type d’ordre. Le principe est pourtant présent, car, s’il ne structure pas obligatoirement chaque instance de l’intérieur, il est à l’œuvre entre elles: les règles de leurs rapport sont censées naître et s’imposer de la même manière que dans un système autorégulé. On en déduira que la gouvernance globale ne saurait déboucher sur un État mondial, ni même sur un gouvernement mondial, sauf à entendre par ces derniers mots la multiplicité des instances participantes elles-mêmes ou, à la limite, l’éventuelle autorité qui, une fois que les accords susdits auraient fait leur preuve par la durée, serait chargée d’en rappeler la teneur aux récalcitrants.
Il n’en reste pas moins vrai que toute la conception incite à considérer les États ou les gouvernements sous un certain angle. Les tenants de la gouvernance commencent généralement leur approche en opposant gouvernement et gouvernance. Le gouvernement, nous disent-ils, a une autorité formelle, c’est-à-dire qu’il a la compétence légale de commander que telle chose soit faite, alors que la gouvernance a la capacité de faire en sorte que telle chose soit faite sans avoir la compétence légale de commander qu’elle soit faite. Sans doute l’opposition tend-elle à se relativiser si l’on quitte le point de vue des affaires intérieures pour celui des affaires internationales où le poids et la puissance prennent le pas sur l’autorité formelle.
Ce n’est pourtant pas ce genre de détour qui conduit certains à faire de la gouvernance un concept qui englobe celui de gouvernement, mais plutôt la remarque selon laquelle la gouvernance peut exister sans gouvernement, alors que le gouvernement ne saurait exister sans gouvernance, sinon en étant inefficace, c’est-à-dire en n’étant pas un gouvernement digne de ce nom. En d’autres termes, l’autorité formelle n’acquiert son efficace que si le gouvernement occupe la place de l’autorité de contrôle qui fait respecter des règles qu’elle a peut-être formulées, mais dont la substance provient des pratiques inhérentes à la société de référence qui peut ainsi (et seulement ainsi) les reconnaître pour siennes.
Si nous prenons la société correspondant à un tel gouvernement comme un tout, elle doit alors être conçue comme un système autorégulé, où les droits fondamentaux attachés aux individus doivent être pensés (ou repensés) selon la logique de la réussite et de l’efficacité qu’ils permettent. Si nous la prenons sous l’angle de la diversité des sphères d’activité qui la composent, nous retrouvons à son niveau une logique analogue à celle que nous venons de rencontrer au niveau de la gouvernance globale. Comme il est postulé en effet que chaque sphère d’activité produit son ordre interne (qu’il soit ou non pensable en termes d’autorégulation), il faut que ces sphères (ou les instances qui les représentent) s’accordent les unes avec les autres. Le gouvernement se réduit-il alors à être le lieu de rencontre où tâchent de s’accorder les représentants de cette polyarchie?
Il est sans doute éclairant d’effectuer le détour par quelqu’un qui, bien avant que l’on ne parle de gouvernance, d’autorégulation et de théorie systémique, paraît avoir pensé quelque chose d’approchant, Edmund Burke. Dans ses Réflexions sur la révolution de France, Burke, comme on sait, s’en prend aux interprétations du «fort éminent» Docteur Richard Price. Price voyait dans la Révolution française la continuation et l’accomplissement du mouvement de libération inaugurée par la Révolution anglaise de 1688, qu’avait déjà poursuivi la Révolution américaine. En destituant le roi Jacques II et en choisissant Guillaume d’Orange pour le remplacer, le peuple anglais avait, selon Price, conquis le droit de choisir lui-même qui le gouverne, le droit de destituer pour indignité ceux qui le gouvernent mal, et le droit d’instituer sa propre forme de gouvernement. Rien n’est plus erroné selon Burke: la Glorieuse Révolution anglaise n’a pour lui strictement rien à voir avec la Révolution française, qui crée une rupture historique, qui prétend rebâtir à partir d’une table rase, et qui suppose une souveraineté populaire. Le corps politique anglais trouve son unité dans l’accord de ces éléments que sont les puissances établies, que l’histoire a vu apparaître et s’imposer, et dont les membres sont des gentlemen (par opposition à la «swinish multitude», la multitude de porcs, que sont les gens du petit peuple). Les rapports entre ces establishments (les grands propriétaires terriens, l’Eglise anglicane, les riches commerçants, les militaires, le monarque …) peuvent être plus ou moins tendus, ils n’en reposent pas moins sur un lien fondamental qu’aucun d’entre eux ne doit briser. C’est à ce lien que Jacques II a failli: loin d’être une rupture, son éviction et son remplacement assurent au contraire la conservation et la continuité du système. Chaque establishment assure un ordre en quelque sorte naturel (par opposition à l’ordre artificiel que veulent instaurer les Français), et le lien entre eux garantit les droits (civils) du peuple. Lequel ne constitue une «swinish multitude» que dans la mesure exacte où il a des prétentions politiques, c’est-à-dire dans la mesure où il se refuse à être simplement représenté par des gentlemen qu’il n’élit pas. Ce que l’on pourrait appeler la polyarchie burkienne suffit à créer un gouvernement, parce que les classes populaires ne disposent pas de droits politiques.
Il est évident que la polyarchie dont nous parlions ne saurait fonctionner de cette manière, parce qu’il faut bien tenir compte des desiderata de citoyens disposant de droits politiques. Ce problème est pour ainsi dire neutralisé au niveau où la gouvernance a les coudées les plus franches (au moins dans ses prétentions), c’està-dire à l’échelon mondial, qui semble être situé hors de la portée des citoyens de base. Les théoriciens se sortent généralement d’affaire en soulignant que la gouvernance ne fonctionne que si elle est «acceptée». Le mot, que ce soit en anglais ou en français, est pour le moins ambigu, puisqu’il peut signifier aussi bien la résignation à la force des choses que la franche adhésion. Une franche adhésion est sans doute préférable, mais la résignation suffit, semble-t-il, aux dits théoriciens pour assurer la compatibilité de la gouvernance et de la démocratie.
Revenons à l’étage d’un pays supposé, justement, démocratique. Le chef du gouvernement n’y sera-t-il qu’un élément parmi les autres de la polyarchie? Il faudra, dans ce cas, qu’il renégocie les accords avec les autres éléments en fonction de l’orientation voulue par ceux qui l’ont élu. Mais cela n’en signifie pas moins que le gouvernement effectif sera en large partie différent de ce qui se présente formellement comme tel. Il reste que, de fait, un chef de gouvernement est en général davantage qu’un élément parmi les autres. C’est ce qui permet à certains de penser la gouvernance comme un «recadrage», que négocierait un chef de gouvernement s’appuyant sur les vœux de ses électeurs et s’alliant à d’autres responsables, de ce que nous avons rencontré sous l’avatar de la gouvernance comme autorégulation d’un système. De tels auteurs peuvent sans doute s’appuyer sur le fait que même les tenants de la gouvernance «globale» prise au sens défini plus haut intègrent des
ordres qui ne sont pas pensables en termes de stricte gouvernance; sans doute aussi la limitation par un de ces ordres des effets des autres ne serait-elle pas imposée d’autorité, mais à travers une batterie d’accords et d’arrangements. Il n’empêche: une telle manière de voir (ou d’espérer) introduit un brouillage du vocabulaire, puisque est ici appelée «gouvernance» un remède (au moins relatif ) à ce que d’autres appellent aussi «gouvernance».
Le brouillage en question traduit l’indétermination qui envahit le terme dès qu’il s’éloigne de son sens d’autorégulation. Le modèle, à ce premier niveau, est celui du marché, et plus généralement celui d’une société fonctionnant selon les mécanismes du marché. Quoiqu’il demeure pour les principaux tenants de la gouvernance le modèle dominant et, qu’idéalement, il s’agirait d’étendre, le modèle se heurte à des domaines d’activité ou à des réalités qui ne relèvent pas de sa logique ou qui y résistent. D’un côté (le côté idéal ou prescriptif ), on peut espérer transformer cette logique; de l’autre (le côté réaliste), on fait passer au premier plan le concept d’ordre: une entité (État, Église …) qui réussit à créer un ordre durable et qui s’avère assez puissante pour avoir une influence mondiale doit être prise en considération. Le principe de gouvernance est alors censé s’appliquer aux rapports entre ces diverses entités, mais au prix d’une perte de rigueur: le terme est alors souvent bien près de signifier simplement accord négocié, voire marchandage, entre puissances hétéroclites. Ce sont à la fois le souci d’ordre et la perte de rigueur conceptuelle qui ouvrent la porte à ceux qui rêvent d’une gouvernance comme recadrage du marché et de ses effets par les États. Envisageable certes jusqu’à un certain point sur le plan pratique, cette vision des choses contredit sur le plan théorique la logique qui a été au départ attribuée au marché. Aussi les tenants d’une gouvernance sans gouvernement, ou d’une gouvernance intégrant les gouvernements comme des éléments parmi les autres, en dépit du fait qu’eux aussi oscillent entre le prescriptif (l’idéal d’autorégulation à répandre) et le descriptif (le réalisme qui intègre les puissances productrices d’ordre), paraissent-ils plus conséquents avec leurs prémisses.
La démocratie est dans cette optique nécessairement repensée comme une manière particulière d’obtenir un ordre. Que ce soit le concept d’acceptation qui arrive sous la plume des auteurs quand ils abordent la question signifie et qu’ils prétendent ne rien imposer par la force, et que la passivité politique s’accorde bien mieux avec leur logique que n’importe quelle turbulence. Le problème est évidemment de savoir si la démocratie ainsi repensée et apaisée mérite encore son nom.
(Le présent article a également donné lieu à une synthèse, que vous trouverez dans le Dictionnaire critique à l'entrée suivante : Gouvernance)


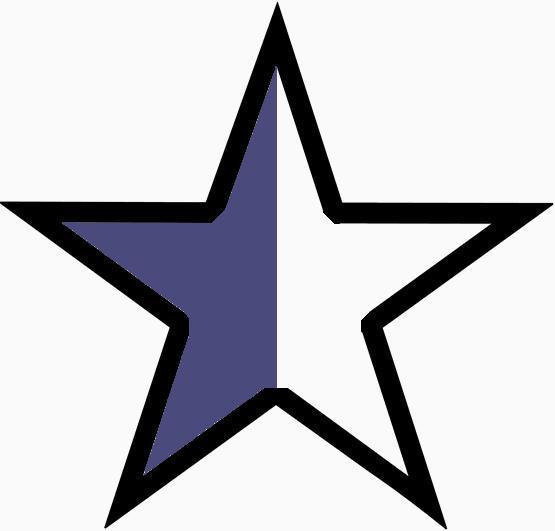
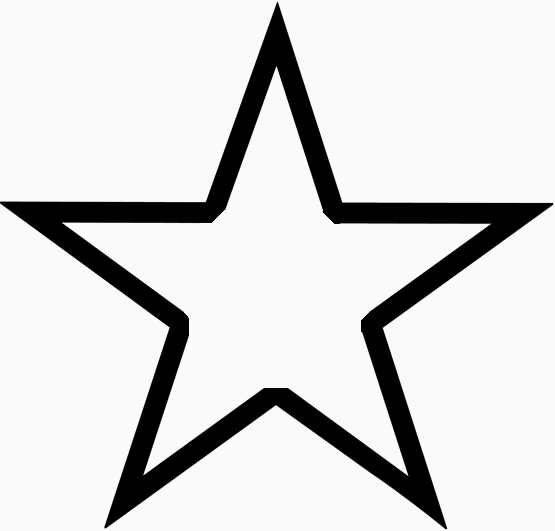


 Actualités
Actualités



