

Quelles relations esthétiques en temps de guerre ?
Source : Eliane Chiron
"L’horreur est un choc, un instant de total aveuglement. L’horreur est dépourvue de toute trace de beauté. On ne voit que la lumière violente de l’événement inconnu qu’on attend. Au contraire, la tristesse suppose que l’on sait. Tomas et Tereza savaient ce qui les attendait. L’éclat de l’horreur se voilait et l’on découvrait le monde dans un éclairage bleuté et tendre qui rendait les choses plus belles qu’elles ne l’étaient auparavant." (1)
Pour parler des nouvelles relations esthétiques, comment ne pas inventer une façon de penser qui suppose une méthode insoumise à tout modèle ? Méthode hybride, faite de morceaux arrachés à l’art et à la vie, où l’art et la vie se grefferont l’un sur l’autre en se coupant et se recoupant à des époques et dans des lieux disparates. Car ce qui est nouveau prend toujours la suite de ce qui est ancien, comme une habitude, tels les soldats américains torturant les irakiens dans les mêmes lieux utilisés aux mêmes fins par Saddam Hussein. De ces coupures de l’art et de la vie, auxquelles j’ai dû finalement me résoudre, car leur violence extrême m’a fait longtemps peur, devrait, par hypothèse, naître le souffle vivant de nouvelles relations esthétiques : relations vivantes (si le rythme est celui d’une danse qui redonnerait vie aux corps détruits) parce qu’issues du vif de ces coupures : coupures à vif comme des corps de femmes violées, assassinées, partout dans le monde, et pas seulement hors de France ou d’Europe. Ce souffle vivant de l’art est ce que Rilke nomme “ un souffle plus ”, qui, dit-il, “ risque plus que la mort ” : ce risque serait celui de l’oubli, de l’accusation de folie, de l’abandon qu’elle entraîne, et du déni. Déni de la non-reconnaissance et de la perte de mémoire. Déni de ce qui se reproduira inéluctablement, embrasant de multiples “ foyers ” se croyant protégés, ni vus ni connus, soit parce qu’ils se croient aux confins du monde, soit qu’ils se prennent pour le centre. Nous tenterons de nous tenir entre les deux.
À vrai dire, dans un article de cette collection de “ L’Université des arts ”, j’avais donné à ce “ souffle plus ” le nom de troisième souffle, qui serait le noyau créateur de la notion d’œuvre aujourd’hui. Ce troisième souffle, ou brise, brisait toute certitude et faisait tout aussi sûrement voler en éclats n’importe quelle mise en doute convenue de la notion d’œuvre (2). Je m’en tiens encore à ce troisième souffle - celui de l’art, celui des artistes, impossible à comprendre pour qui se place dans des relations de pouvoir - tant cette brise si ténue demeure à l’écart des catégories répertoriées. Pour avoir quelque chance de ressaisir ce troisième souffle, il faut se risquer (“ d’un risque plus risquant ”, disait Rilke) dans le milieu où il se forme. Un milieu brisé. À vrai dire ce milieu est insaisissable comme un tas de décombres ou de cadavres après un attentat, ou une ville déchirée par les bombes, ou des corps amputés ou violés dans les guerres. On peut simplement dire que ce souffle est, au milieu de ces débris de corps humains, ce qui les met en mouvement en les sauvant de l’oubli, les déplace, nous les jetant à la figure, effaçant nos visages, nous retournant l’estomac, envoyant par-dessus bord les idées bien convenues des intellectuels pétris de certitudes. C’est un souffle lui-même brisé entre le proche et le lointain, et par là même apte à franchir, dans une sorte de tourbillon, les ruptures de genres, les failles de temps et de lieux. Les citations participeront des chocs entre le proche et le lointain, rapprocheront de nous ce qui restait lointain. Ce souffle périphérique bousculera mon discours, le secouera en tous sens, mettra le tissu de l’histoire en charpie, passant par la deuxième guerre mondiale, afin quelle s’entrechoque avec la mondialité d’aujourd’hui, et pas seulement pour la mettre sagement en perspective. Les chercheurs, pas plus que les artistes, ne sont plus (ne peuvent plus être) dans leur tour d’ivoire (qui pourrait bien, si nous n’y prenons garde, ressembler à un mirador, avec son très froid point de vue panoptique). En effet, qu’il s’agisse de prostituées (surtout celles, mineures si possible, des pays de l’est, à la peau si blanche et si appréciée) qu’on envoie massivement sur les trottoirs de France et de Paris, réputés les plus chers du monde, ou qu’il s’agisse de guerres engagées sous couvert de défense de nobles valeurs : principes démocratiques, liberté, que sais-je encore, le résultat est le même : des vies sacrifiées, dans un immense potlatch où tout à la fin est permis, où la vie humaine n’a plus aucun prix : d’abord la vie des femmes dans les sociétés, ensuite la vie des hommes et des femmes en temps de guerre.
"À la frontière chinoise, Pékin et Pyongyang traquent sans relâche les réfugiés nord-coréens […] Bien sûr, la traque s’accompagne du plus grand cynisme. Les réseaux de trafic de femmes nord-coréennes, condamnées à la prostitution ou vouées à des mariages achetés, sont toujours à l’œuvre dans cette région frontalière de la Chine […] Une nord-coréenne “ jolie ” se vendrait 8OOO yuans (810 euros) et une “ non-jolie ” pour moitié prix." (3)
Une infirmière militaire de la base allemande de Landstuhl, dont l’hôpital accueille les blessés américains de la guerre d’Irak, parle d’un jeune lieutenant de West Point :
"Quand il presse ses poings sur ses yeux et qu’il balance sa tête d’avant en arrière, il ressemble à un petit garçon. Mes dix-neuf blessés d’aujourd’hui ressemblent tous à des petits garçons, mais ils ont perdu des membres, la vue, voire pire. […] Il est vraiment dommage que Bush n’ait pas pu nous inviter aux festivités." (4)
Dans le même article sur “ les sacrifiés des guerres américaines ”, les scènes d’hôpitaux se succèdent :
" L’expression “ blessés graves ” est loin de refléter la réalité dans toute son horreur. La mère du sergent Feldbush, Charlene, qui depuis deux mois passe avec son mari pratiquement tout son temps au chevet du blessé, a vu un jour une jeune militaire qui se traînait dans les couloirs accompagnée de son fils de trois ans. Elle était amputée des deux jambes."
Il y a peu, l’actrice Cher a déclaré qu’elle avait passé la journée au Walter Reed Hospital de Washington avec des soldats revenus de la guerre :
"La première personne que j’ai croisée était un jeune garçon de 19 ou 20 ans auquel il manquait les deux bras. […] Là-bas, tout le monde a perdu soit un bras, soit une jambe, et parfois même les deux. […] je me demande aussi pourquoi […] Cheyney, Wolfowitz, Bremer, le président…enfin pourquoi ils ne posent jamais en photo avec tous ces gens-là."
J’entends dire que la violence est la même partout, par exemple dans nos lieux de travail, comme si c’était un argument pour l’admettre et la supporter passivement. Virginia Woolf en parle déjà en 1938 :
"L’éducation, loin d’enseigner la générosité et la magnanimité aux gens cultivés, les rend au contraire si avides de conserver leurs biens, “ la grandeur et le pouvoir ” dont parle le poète et de les tenir bien en main, qu’ils n’emploieront pas la force mais des méthodes infiniment plus subtiles que la force lorsqu’on leur demandera de partager cette grandeur et ce pouvoir. Or la force, l’instinct de possession ne sont-ils pas étroitement liés à la guerre ? " (5)
Tous ces témoignages, comme la plupart de ceux concernant la violence, sont énoncés par des femmes ou les concernent. Quand s’apercevra-t-on que notre époque, depuis longtemps, réclame une pensée différente à la mesure des droits consentis aux femmes depuis peu ? Ne parlons pas du droit de vote octroyé aux femmes françaises, depuis Alger où siégeait le gouvernement provisoire en 1944, mis en œuvre seulement en 1945, au motif que, tous les hommes n’étant pas rentrés de la guerre, il y aurait un déséquilibre dans le vote et qu’en conséquence, il n’aurait pas été représentatif. Comme s’il l’était lorsqu’il excluait plus de la moitié de la population. Preuve que sans droit de vote, les femmes n’avaient aucune existence reconnue. Sont-elles, depuis, autre chose que des bulletins de vote ou des procréatrices permettant la reproduction de l’espèce ( voir le slogan “ Travail, Famille, Patrie ”), ce n’est pas le lieu d’en débattre. L’on peut cependant se demander si, à peine soixante ans plus tard, c’est-à-dire à peine deux générations passées, les esprits ont changé à la mesure des lois votées, dont certaines font machine arrière. Et si je projette de parler d’artistes qui sont aussi des femmes, si les grands artistes sont de plus en plus de grandes artistes, serait-ce que, soit qu’être artiste a perdu de sa valeur, soit qu’il s’agisse d’un “ débouché ” maintenant accepté pour les filles des classes élevées de la société ? À moins que les femmes aient majoritairement aujourd’hui, en plus d’une formation en principe égale à celle à laquelle ont eu droit leurs frères durant des siècles, non seulement une culture mais aussi une sensibilité qu’il faut bien appeler “ esthétique ”. Si j’en reviens au droit de vote des femmes, en France, en 1944, l’on admettait que les veuves de guerre et les épouses de prisonniers ne pouvaient voter que comme l’auraient fait leurs époux, dont on supposait qu’elles fussent seulement leurs reflets. Ce déni du cerveau des femmes a un nom en sociologie : le refus de la légitimation. Virginia Woolf avait inventé depuis longtemps les théories qui furent celles du sociologue Pierre Bourdieu, mais elle ne fut pas entendue : elle fut traitée de folle, et pire encore, de frigide. Il est vrai qu’elle se noya, le 28 mars 1941, au début du printemps, au début des promesses d’un renouveau de la nature auquel elle ne croyait plus, traquée depuis longtemps par une société propre à broyer les femmes comme elle, une société où elle se sentait en exil, étrangère à ses lois, car cette société portait aussi en germe le nazisme, comparable selon elle (et elle le prouve) à la manière dont y étaient considérées les « filles des hommes cultivés » (6). Mais si Virginia était unique, en tant que femme, Walter Benjamin, également, philosophe allemand, nerveusement fragile, on le sait, également rebelle à son milieu social, qui se suicida à la frontière espagnole en 1941, et Carl Einstein qui se jeta dans le gave de Pau en 1940, et Stefan Sweig, exilé au Brésil, suicidé en 1942. Tous en période de guerre, à cause de la guerre. D’eux on ne dira jamais qu’ils étaient fous, dépressifs ou frigides… Mais l’on peut remarquer que la question du suicide acquiert sa plus grande acuité en temps de guerre :
"Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie ."
On aura reconnu les deux premières phrases du Mythe de Sisyphe(7). Tout cela est du passé, direz-vous. Certes, mais à cette époque, si peu de temps après la boucherie de la guerre de 1914-1918, c’est par la guerre, encore, que s’affirma la mondialisation. On dit que la mondialisation est celle de l’économie libérale, du capitalisme, du chômage, alors qu’elle est d’abord et toujours celle de la guerre, aujourd’hui éclatée en de multiples pays sans liens visibles avec les autres, au mieux nous en sommes informés dix ans plus tard (voir le génocide au Rwanda). Si les guerres ne purent s’opposer, bon gré mal gré, à une présence accrue des femmes dans les sociétés, cette présence active est encore une guerre à faire chaque jour, et pourtant on n’a pas envie de la faire, cette guerre-là, pas plus que les autres. Mais voyons un exemple parmi des milliers d’autres : le titre d’une rubrique dans le supplément de télévision du journal Le Monde du milieu d’avril 2004, évoquant Josette Clotis, écrivaine, qui rencontra André Malraux dans les années trente. Qu’est-il écrit ? qu’elle “ ne devint jamais Madame Malraux ”. Pourquoi lui ôter, même dans un improbable mariage, son nom, sous lequel elle publia son premier roman chez Gallimard, alors que la loi napoléonienne, toujours valide, ne l’impose nullement ? Quand ce genre de formule apparaîtra-t-il enfin obsolète ? Pour dire combien l’époque nazie imprégna la vie de Virginia et la conduisit très sûrement à la mort, il faut la relire aujourd’hui, en tissant avec son œuvre, précisément, de nouvelles relations esthétiques, à la manière dont le fait Viviane Forrester. Relisez Trois guinées écrit en 1938, où elle pressent que le nazisme avec les uniformes du Furher et du Duce, la guerre d’Espagne avec son lot de photos de guerre insoutenable qui arrive chaque semaine en Angleterre, relèvent du même système qui habille de vêtements d’apparat les hautes fonctions réservées aux “ hommes cultivés ”. Trois guinées est la réponse de l’écrivaine à un homme qui lui a demandé : “ Comment faire, à votre avis, pour empêcher la guerre ? ” S’appuyant sur des faits précis, des textes référencés, implacables, Trois guinées assène les preuves qu’une société qui écarte des plus hautes fonctions les femmes, est meurtrière et pousse inexorablement à faire la guerre. À commencer par ce qu’elle appelle la “ fonction publicitaire ” des vêtements des “ hommes cultivés ” :
"Votre habillement à vous, si élaboré […] sert à afficher votre statut social, professionnel ou intellectuel. Si vous permettez cette humble comparaison, vos vêtements remplissent l’office des étiquettes chez l’épicier. […] Quel est le lien possible entre la splendeur vestimentaire des hommes cultivés et les photographies de maisons en ruines et de cadavres ? Le lien entre les vêtements et la guerre n’est certes pas difficile à découvrir ; vos tenues les plus belles, ce sont vos costumes militaires ”. Nous retrouvons dans les cours et les universités, le même goût pour la parure. Ici aussi foisonnent le velours, la soie, la fourrure et l’hermine." (8)
Le film afgan Osama, de Siddig Barmark (2003) montre l’entraînement des jeunes garçons à devenir talibans : cela commence par l’apprentissage du drapé harmonieux d’un turban, à savoir d’un uniforme. Le turban est blanc, insidieux symbole de paix, de “ pureté ”. Ruban de Mœbius aussi, où la blancheur ne peut être distinguée de la noirceur. À la fin de l’apprentissage, le turban sera l’emblème de tous les privilèges : circuler en jeep ou camionnette, se servir d’un fusil et posséder, quand on accède au rang de mollah, des jeunes filles à peine pubères qu’on enferme à double tour pour le reste de leur vie. Dans l’Afghanistan des talibans, les autres hommes sont morts ou en exil et les femmes n’ont pas le droit de travailler. En 1938 se prépare en Espagne la deuxième guerre mondiale et telle est aussi la révolte de Virginia, dans cette Angleterre victorienne dont l’Empire colonial était encore intact. La guerre d’Espagne y a déjà une ampleur mondiale. Qu’écrit Virginia ?
"Là, par bonheur, l’année sacrée, cette année de 1919, vient à notre secours. Les filles d’hommes cultivés détiennent depuis cette année-là le droit de gagner leur vie."
Relisons Virginia Woolf :Trois guinées n’a pas vieilli, si nous entendons par “ nouvelles relations esthétiques ”, non pas l’invention de nouvelles doctrines (genre esthétique relationnelle) pourvoyeuses de positions de pouvoir avec disciples et mainmise d’un petit groupe sur des lieux de culture (le Palais de Tokyo par exemple), mais la résonance de la violence mondiale dans l’attitude esthétique qui ne peut, moins que jamais, ignorer que l’autre côté de la terre est à quinze heures d’avion en moyenne, que nous sommes désormais responsables de l’avenir de la planète entière, parfaitement informés des atrocités perpétuées dans d’autres lieux que le monde occidental (et dans ce monde occidental lui-même), et ne plus faire comme si nous ne savions pas. Si nous pensons que les artistes peuvent se tenir à l’écart des violences d’une planète devenue si petite que les atrocités qui se commettent tout à côté ne sont pas de nature différente mais éventuellement (éventuellement seulement) de moindre degré, et si nous pensons que les jugements esthétiques puissent faire de même, nous n’avons qu’à nous rhabiller, comme on dit. Avec les tenues de camouflage de la guerre économique qui laisse les mains propres : costume gris l’hiver, beige en été. Entendons-nous bien, il s’agit de tenter d’inventer une autre façon d’être au monde, au plus près du sensible et des émotions, préalables indispensables à la pensée rationnelle. En somme, de ce qu’on nomme aujourd’hui la part du féminin dans la création, trop longtemps et trop souvent encore minorée. Car si “ commencer à penser, c’est commencer à être miné. La société n’a pas grand-chose à voir dans ces débuts ”, l’art est la longue chaîne de gestes et d’actions de révolte contre “ l’hostilité primitive du monde, qui, à travers les millénaires, remonte vers nous » (9).
"Au début du XXè siècle, 10 % des victimes de guerre étaient des civils. À la fin du XXè siècle, le rapport s’est inversé : de 8O% à 90% sont civiles." (10)
Partie de l’obsession de la violence à travers l’omniprésence de la guerre sous toutes ses formes et partout, l’idée s’est imposée que le corps de l’artiste-femme (emblématique de la part féminine du corps créateur de tout artiste) était aussi la métaphore du corps social dans son état actuel. J’en suis arrivée là par la sensation du passage à travers la porosité d’un corps-enveloppe impénétrable et proliférant qui contient l’infini du temps. Le corps créateur est un corps virtuel animé du désir de franchir ses propres frontières. L’œuvre entier de Virginia Woolf multiplie ces trangressions, par l’invention d’une écriture chirurgicale, sûre d’elle-même, précise, découpant au scalpel des “ moments d’être ”, des scènes où rien ne manque, tranchant à la hâte au travers des frontières établies, les abolissant froidement, afin d’ouvrir, comme une blessure ouverte, un regard à cheval sur ces frontières . Frontières de sexe et de siècle avec Orlando, de classe sociale, de parenté et de langage, de sphère publique et de vie privée aussi, lorsqu’il est question de ses demi-frères incestueux, Gerald et Georges, dans son journal ou dans les conférences devant ses amis du célèbre groupe de Bloomsbury.
Par exemple, dans “ Une esquisse du passé ” :
"Il y avait près de la porte de la salle à manger une console pour poser les plats. Une fois, Gerald Duckworth me hissa dessus, et pendant que j’étais assise là il me mit à explorer ma personne. Je me rappelle encore la sensation de sa main s’insinuant sous mes vêtements, descendant sans hésiter, régulièrement et de plus en plus bas. Je me rappelle que j’espérais qu’il cesserait, que je me raidissais et me tortillais tandis que sa main approchait de mes parties intimes. Mais il ne s’arrêta pas. Sa main s’approcha de mes parties intimes aussi. Je me rappelle que je me suis sentie offusquée, rebutée – quel mot conviendrait pour un sentiment aussi vague et mélangé ? Il devait être violent puisque je m’en souviens encore. Cela semble montrer qu’un sentiment concernant certaines parties du corps – qu’il ne faut pas les toucher, qu’il est mal de les laisser toucher – doit être instinctif. Cela prouve que Virginia Woolf n’est pas née le 25 janvier 1882, mais née des milliers d’années auparavant ; et qu’elle a dû affronter dès le début des instincts déjà acquis par des milliers d’aïeules dans le passé." (11)
Par exemple encore, dans “ 22 Hyde park Gate ”, parlant de Georges se glissant dans son lit après les soirées mondaines où, comme sa sœur Vanessa, elle devait l’accompagner :
"Oui, les vieilles dames de Kensington et de Belgravia ne se doutèrent jamais que Georges Duckworth n’était pas seulement un père et une mère, un frère et une sœur pour ces pauvres petites Stephen ; il était leur amant aussi." (12)
Loin d’employer une langue “ prude ”, comme on s’est plu à le répéter, Virginia invente une sexualité féminine qui diffuse la dimension paradoxale du temps. Elle dit que le corps humain, s’il est humain, ne connaît pas d’état de “ nature ”, qu’il est inséparable des traces acquises, inscrites à même le cortex cérébral. Dans L’insoutenable légèreté de l’être, Milan Kundera fait dire à Tereza que les photos de nudistes sur la plage sont la même chose que les images des détenus dans les camps de concentration. Cette dimension temporelle dans laquelle nous vivons, davantage que dans l’espace, fait de l’art un passage frayé devant soi, à rebours de notre temps de vie, bousculant toute généalogie et tout lien familial. Tout passage créateur est une transgression de la loi du plus fort. Cette transgression s’opère par un passage paradoxal du temps, que seul l’art peut accomplir : temps de l’écriture pour Virginia, à rebours vers l’enfance, temps de la parole pour Shéhérazade, et pour elles, comme pour Albertine dans La Recherche du temps perdu, conception par l’art de leur corps d’artiste. Un corps en lutte pour avoir un nom qui le fait disparaître, le mettre à l’écart du monde des vivants.
Shéhérazade, dans les Contes des Mille et une Nuits, sera la première figure emblématique du passage. Ces contes mettent en scène le seuil interminable de son corps (prêt à être tué mais qui ne l’est jamais), dont on n’étouffe pas le souffle interminable de la vie et de la voix (celles-ci : la vie et la voix, la voix de l’art, se confondant). Chaque nuit, Shéhérazade invente un conte afin d’échapper à la mort. Et cela indéfiniment. Ce qui prolifère dans les contes de Shéhérazade, se concentre dans la nuit de son corps, par sa voix qui s’en échappe en inventant la suite infinie des récits et des nuits (mille et une) est le Temps. Shéhérazade est une grande Figure du temps, comme Albertine, ce personnage central de l’interminable roman : La recherche du temps perdu de Marcel Proust. La partie centrale du roman, La prisonnière, fut ajoutée par l’écrivain tout à la fin de l’écriture. Albertine m’apparaît ainsi comme l’infracassable noyau créateur du roman proustien (13).
D’Albertine, Proust a dit qu’elle était “ comme une grande déesse du Temps ”, en ce qu’elle représentait pour lui la prolifération du temps, et la prolifération incommensurable concentrée en chacun des instants. Cette prolifération tératologique (monstrueuse) a lieu chez Proust dans la rencontre des instants produite par des chocs (le bruit de la fourchette ou celui du marteau entrant en contact, à travers le temps, avec le bruit des pas sur les pavés de la cour de l’hôtel de Guermantes ou le porche de la Basilique Saint Marc à Venise. Le temps, chez Proust est fait de la discontinuité proliférante des instants féconds de Bachelard. C’est pourquoi, sous son enveloppe de peau où se succèdent toutes les teintes allant du rose au cramoisi presque noir, se creuse un abîme insondable qui est l’abîme de l’inconnu, l’abîme du temps.
"…cette beauté qu’en pensant aux années successives où j’avais connu Albertine […] je lui avais trouvée depuis peu et qui consistait en ce que mon amie se développait sur tant de plans et contenait tant de jours écoulés, cette beauté prenait pour moi quelque chose de déchirant. Alors sous ce visage rosissant, je sentais se creuser comme un gouffre l’inexhaustible espace des soirs où je n’avais pas connu Albertine. […] Je pouvais la caresser, passer longuement mes mains sur elle, mais, comme si j’eusse manié une pierre qui enferme la saline des océans immémoriaux ou le rayon d’une étoile, je sentais que je touchais seulement l’enveloppe close d’un être qui, par l’intérieur, accède à l’infini. […] Car si son corps était au pouvoir du mien, sa pensée échappait aux prises de ma pensée." (14) ( Cité par Bataille).
Shéhérazade et Albertine sont au cœur de La recherche du temps perdu et de L’expérience intérieure de Bataille. Cette expérience intérieure est celle du temps qui prolifère dans le corps créateur. Au vrai, le corps créateur n’est fait que de ce temps démultiplié au gré de l’expulsion des œuvres. L’expérience intérieure est l’imminence de ce temps expulsé dans le retournement sur elle-même de la peau-enveloppe. L’enveloppe immémoriale du corps créateur n’est qu’un abîme qui déborde d’un temps incommensurable. C’est pourquoi Shéhérazade et Albertine nous disent l’impossible possession malgré la volonté d’enfermement. La part d’inconnu qu’elles portent en elles, dans leurs noms, dont elles sont le réceptacle, est pour E. Lévinas l’absolument autre, à savoir la mort. “ Ich sterbe ” : je meurs, dit Anton Tchekov en allemand, à son médecin allemand (15) , dans cette ville étrangère où il était parti pour “ crever ”, avait-il dit. Parole de médecin un corps de l’écrivain, parole étrangère en terre étrangère qui rompt l’enveloppe de silence, retourne en corps créateur – comme un gant - le corps exténué, rongé par la tuberculose. Retourné par la parole, ce corps ne crève pas, il meurt, humainement, comme un personnage de théâtre. Rompant avec la vie nue de celui qui va “ crever ”, Ich sterbe donne rétrospectivement une parole “ vivante ” à tous les personnages du théâtre de Tchekov qui se sont suicidés en coulisses et continueront à le faire au gré des représentations. Cette parole tirée des dernières forces, parce qu’étrangère et exilée, transmise à un étranger, leur donne un lieu, à l’écart de tout lieu assignable :
"…mais moi, rassemblant ce qu’il me reste de forces, je tire ce coup de feu, j’envoie ce signal, un signe que celui qui de là-bas m’observe reconnaît aussitôt : Ich sterbe…vous m’entendez ? je suis arrivé jusqu’au bout…Je suis tout au bord…Ici où je suis est le point extrême…C’est ici qu’est le lieu.
…c’est à vous que je le dis : Ich sterbe.
À vous. Dans votre langue.
Avec ces mots bien affilés, avec cette lame d’excellente fabrication, elle ne m’a jamais servi, rien ne l’a émoussée, je devance le moment et moi-même je tranche : Ich sterbe." (16)
Ce qui est proliférant dans le corps créateur à l’état de virtualité qui s’actualise dans les œuvres, est l’approche bouleversante, tremblée et retenue de l’instant de la mort retourné en puissance de vie de l’art. C’est ainsi que Jacqueline Salmon, notamment dans la série de photographies : Le Hangar (2001), met en scène des enveloppes indéfiniment vides. Si nous regardons longtemps les photographies du Hangar, nous pouvons comprendre que le corps de l’artiste est le corps créateur – corps social aussi bien - impossible à posséder, à enfermer. Le Hangar (2001) est un ensemble de photographies du Centre de réfugiés de Sangatte, dans le Pas-de-Calais en France, aujourd’hui supprimé. Le hangar rectangulaire est occupé par des tentes, également rectangulaires (mises en abyme, donc), destinées aux réfugiés venus des pays du Moyen – Orient. Le hangar et les tentes sont, sur les photos, vidés de toute présence humaine, à part deux ou trois personnes qui dorment en plein jour sous des couvertures et dont on ne peut savoir si ce sont des hommes ou des femmes. Cela importe peu. Les réfugiés de Sangatte veulent se rendre en Angleterre où ils n’auront pas à faire la preuve de leur identité. L’enfermement des demandeurs d’asile dans le hangar de Sangatte ne fait que retarder leur fuite par l’Eurotunnel, puisqu’on sait qu’ils finissent toujours par passer, par s’enfuir, s’évader. Sans doute est-ce cette évasion qui laisse les lieux vides à la fin, et qui construit les images de Jacqueline Salmon. Images de lieux désertés par ceux que les autorités ont voulu enfermer. Images aussi de la périphérie que l’on prend souvent à tort pour ce qui est loin du centre et aux confins, comme les banlieues. La périphérie est tout autre chose : le rapport transcendant de la circonférence d’un cercle à son diamètre . C’est la periphereia.
Sur fond de cette violence qu’est la mort, l’artiste iranienne Shirin Neshat, dans son film Passage (2001), réalisé en couleur, montre l’accomplissement de la transcendance dans l’image de la périphérie que trace l’ensemble du film. Au demi-cercle d’une plage longé au début par les hommes au bord des vagues de la mer, répond le demi-cercle de feu allumé à la fin par une petite fille, symbole d’espoir, lorsque les hommes, avançant en ligne, déposent à terre le cadavre qu’ils portaient, tout près d’un cercle de femmes et de la terre qu’elles ont creusée de leurs mains.
La violence n’apparaît comme telle que lorsqu’elle est connue et non pas étouffée. La violence dans l’art serait celle du passage de la violence tenue secrète à la violence rendue visible dans son retrait. Il me semble qu’il y a ce passage-là dans les œuvres des femmes. Et qu’en tant qu’artistes, cela est de plus en plus reconnu. Cela diffère du travail d’information journalistique, mais on sait que cette “ information ” (même lorsqu’il s’agit de faire connaître des actes de barbarie), non seulement est montrée, tout en étant filtrée, partielle, manipulée comme lors de la guerre du Golfe, qualifiée à l’époque de “ guerre propre ” L’art donnerait à voir, à bien y regarder pourtant, cette part de féminin archaïque qui est aussi une part d’enfance, non pas violent mais sauvage, incontrôlable, non manipulable, qui est un retour à l’origine, qui fait peur et dont on voudrait nier l’existence. Par exemple, la déesse grecque Artémis que Jean-Pierre Vernant a réhabilitée dans sa version la plus antique. Artémis est par excellence la déesse du passage, la déesse des marges. Elle se distingue d’Hermès par son appartenance au monde sauvage, marginal, où elle réside, ce qui la fait proche du centaure, mais aussi des sorcières qu’on brûla pendant des siècles car il n’était pas tolérable qu’elles aient acquis dans la solitude et la sauvagerie des forêts un savoir qui ne devait rien aux hommes. Un savoir, donc, maléfique, qu’elle devaient quand même bien tenir de quelqu’un. Puisque le vrai savoir venait des livres, eux-mêmes issus de la parole de Dieu, le savoir des femmes ne pouvaient venir que du “ malin ”, il était donc diabolique et déchu, ce savoir, car il faisait la part du corps, du corps sensuel des femmes, qu’il fallait donc brûler, et avant, torturer, et violer. Artémis, possédant l’art de la chasse prépare les jeunes filles à passer de l’état d’enfance à celui d’adulte. Ce passage, primordial, du temps naturel au temps humain, s’opère toujours de façon violente car c’est toujours une rupture . Comme tout passage initiatique qui fait d’un être un véritable humain. Sauf que c’est au mariage qu’Artémis doit conduire les jeunes filles : pour les jeunes grecques, devenir une femme consiste à se marier, comme à l’époque de Virginia Woolf…Et aujourd’hui ?
L’artiste, surtout quand c’est une femme, tient toujours de la sauvagerie de ces figures féminines archaïques qui refusent la loi qui leur est imposée, préférant inventer la leur. Comme les millions de réfugiés partout dans le monde, qui œuvrent au métissage mondial, l’artiste n’existe en aucun lieu précis, n’a pas d’identité fixe, ni d’appartenance sociale. La violence cachée dans les œuvres n’a pas de forme définie, elle est une traversée paradoxale, à rebours, de la nuit où règne la confusion, où les trajets se recoupent sans se voir. La nuit est l’équivalent de la mort toujours violente. Mais l’art est la vie qui continue et la mort vaincue. L’art fait naître dans la nuit la plus noire des constellations, et ce sont elles dont il faut saisir le souffle, tiède et parfumé durant les nuits d’été, qui caresse le corps et agrandit l’esprit aux dimensions du ciel étoilé. Si la violence de la mort, dans l’art, est au centre des œuvres, elle est celle de la brise aurorale qui sépare la fraîcheur de la nuit et la douceur amère du jour, sauvegardée comme la promesse brisée des vies que nous aurions pu vivre, ou des vagues qui se brisent sur le rivage. Virginia Woolf écrit son premier souvenir :
"Je suis au lit, à demi réveillée, dans la chambre des enfants, à Saint-Ives. J’entends les vagues qui se brisent, une, deux, une, deux, et qui lancent une gerbe d’eau sur la plage ; et puis qui se brisent, une, deux, derrière un store jaune. J’entends le store traîner son petit gland sur le sol quand le vent le gonfle. Je suis couchée et j’entends le giclement de l’eau et je vois cette lumière, et je sens qu’il est à peu près impossible que je sois là ; je suis en proie à l’extase la plus complète." (17)
Car l’art est le passage à rebours de la mort à la vie. La vie après les guerres inévitables. La vie de l’art malgré la mort des artistes. Ce que nous voyons à la fin du film de Shirin Neshat. Et tout me porte à croire qu’il y a là un autre modèle de mondialisation, où triompherait une utopie : l’enfance de l’art. Mais les artistes qui se suicident sont celles et ceux qui, traversés par les guerres dont l’impression qu’ils en ont les étouffe, sentent que l’art ne les console plus de la vie. Ils sont comme la Rhoda des Vagues, songeant :
"Je suis seule dans un monde hostile. La race humaine est atroce. Je vogue sur des flots agités. Et lorsque je sombrerai, personne ne sera là pour me sauver." (18)
Une autre forme de violence, plus insidieuse, existe, non pas tant dans les œuvres des femmes mais dans l’incompréhension qu’elles suscitent.
Parler du Hangar de Jacqueline Salmon en termes humanitaires revient à renvoyer non pas l’artiste mais la femme à ses fonctions ancestrales de soigner les corps à la guerre et dans les hôpitaux. Renvoyer son œuvre à une fonction humanitaire. Or cette fonction humanitaire, qui m’a toujours parue louche car instituant une relation de domination, s’éclaire d’un éclairage atroce qui n’a pas fait, semble-t-il, assez de vagues. Il s’agit d’un encart, page 24 du magazine Elle du 11 mars 2002 (il est vrai un journal féminin…)
"Pour obtenir une bâche en plastique ou une couverture, de jeunes réfugiées étaient contraintes, par les travailleurs humanitaires, à des rapports sexuels. Cela s’est passé dans les camps au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone, dans cette Afrique de l’ouest percluse de violences et de guerres civiles. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et lONG britannique Save the children ont eu le courage de rendre public cet énorme scandale (je ne vois pas où est le courage). Alertés par les responsables sur le terrain, ils ont envoyé, à l’automne dernier, une mission d’évaluation. Mille cinq cents enfants et familles ont été entendus. Leurs témoignages concordants citent soixante-sept personnes qui auraient donné de l’aide humanitaire contre du sexe. Aujourd’hui c’est une commission d’enquête à des fin judiciaires que le HCR diligente en Afrique de l’Ouest. “ Et nous allons changer notre manière de faire, explique Corinne Perthuis, porte-parole du HCR. Une de nos priorités est d’embaucher plus de femmes. Si nous avons rendue publique cette affaire, c’est pour interpeller nos partenaires. Et protéger les adolescentes ” ".
Les critiques, trop souvent, s’attachent aux figures interchangeables de la mère et de la prostituée. La première qui soigne les corps, la seconde qui offre le sien. Sacrifice dans les deux cas, retournement des rôles à chaque instant : les femmes passant d’une famille à l’autre, les prostituées se livrant à des passes. Dans des lieux clos. Sommes-nous si loin du Hangar ? “ Attesté en Picardie, le mot Hangart (1135), sans doute d’origine francisque, s’est répandu plus tard en français. Il représente un composé haim-gard “ clôture autour de la maison ” (de haim, v. hameau, et gard. v. jardin). Haim, all. Heim domicile, foyer. Angl.home. ” (Bloch et Warburg).
Dans Sangatte il y a les mots sang et gate (le pont en anglais). Si donc nous passons par les mots et les noms sur lesquels se fonde l’œuvre de Salmon, le Hangar serait un home de passe, une maison close où se métisseraient des sangs migratoires, dans des passages comparables à des “ passes ” où chaque partenaire de la passe aurait perdu ou volontairement abandonné son identité. Le Hangar en ce début du XXIè siècle est un modèle réduit de ce monde-enveloppe que Malévitch compare à un tamis troué dont les trous ne sont pas vides. Par le hangar prolongé par l’Eurotunnel creusé sous la mer, s’échappent les réfugiés sans nom ni nationalité. Dotés d’un corps-enveloppe sans identité, ils ont des corps-passages à l’égal du monde, d’où s’écoule un sang nouveau. Ils vont vers la vie, vers “ le risque plus risquant ”, libres de toute appartenance. Apatrides, ils se risquent dans le temps, s’y infiltrent, créant ici et là où on ne s’y attend pas, des noyaux créateurs de musique, de danse ou d’images. Asociaux, résolument, ils transportent la transcendance contenue dans le nom de periphereia. La périphérie transporte la circonférence du cercle à son diamètre qui coupe en deux ce cercle, comme un éclair zèbre les ciels d’orage. Les nouvelles relations esthétiques, aujourd’hui, devraient être semblables à ces éclairs produits par la foudre éclairant la nuit ou la traversée sous-marine de l’Eurotunnel, à l’écart de l’histoire et pourtant en son cœur. C’est ce qui est menacé dans l’art qu’il faut aimer, ce qui est oublié qu’il faut sauver, ce qui est faible comme un souffle qu’il faut recueillir, ce qui est déchu qu’il faut regarder. Avec amour. Cet amour que Socrate tenait de Diotime : une femme, une étrangère, et qu’il s’était donné pour tâche de transmettre. C’est notre plus précieux héritage. Oui, la compassion, la Pitié dont parle Barthes à la fin de La Chambre claire, inspirée de Nietzsche, à l’égard de ce qui est faible, trahi, mis à l’écart, est une urgence de chaque instant. Il s’agit d’accroissement existentiel. Celui de Tomas par exemple, en Tchécoslovaquie, après le printemps de Prague écrasé par les chars russes. Tomas, chirurgien, apprend en même temps que Tereza, selon un trajet parallèle où il refuse le régime totalitaire de son pays, où il accepte tous les degrés de la déchéance sociale qui en découle, ce qu’est “ l’insoutenable légèreté de l’être ” et de l’histoire, dans le renoncement à la force et l’acquiescement à la faiblesse, en marge de toute sa vie passée, ayant même coupé un à un tout lien familial :
"La planète pouvait vaciller sous les déflagrations des bombes, la patrie pouvait être chaque jour pillée par un nouvel intrus, tous les habitants du quartier pouvaient être conduits au peloton d’exécution, il aurait supporté tout cela plus facilement qu’il n’eût osé se l’avouer. mais la tristesse d’un seul rêve de Tereza lui était intolérable.
Il l’imaginait morte…
Elle faisait des rêves atroces et il ne pouvait pas la réveiller." (19)
Il faut aimer dans l’art ce qui va mourir. Tereza est belle, comme Ottilie des Affinités électives de Gœthe, pace qu’elle va mourir à la terre, avec Tomas, et après le chien Karenine, qui lui aussi a traversé la guerre. Et c’est Sabina, l’artiste-peintre, solitaire, qui nous l’apprendra, un peu plus tôt dans l’ouvrage, exilée en Amérique. Grâce à l’amour qu’elle leur porte, Tereza et Tomas, pourtant morts, continuent de vivre.
Notes :
(1) Milan Kundera, L’insoutenanable légèreté de l’être (1984) trad. F. Kérel (1987), postface F. Ricard (1989) , nouv. éd. revue par l’auteur, Paris, Gallimard, 1990, p. 443.
(2) Il est courant d’entendre des prises de pouvoir des critiques sur les artistes, qui s’apparentent à des usurpations : “ je suis artiste si je le déclare, en effet je fréquente des artistes, je les invite à dîner, je parle d’eux (ou plutôt je me sers d’eux pour écrire mes articles et mes livres) donc toute parole qui sort de ma bouche me fait artiste, etc. ”, tout cela dit du haut d’une estrade de colloque international, bien entendu). Il n’est pas question des critiques et philosophes engagés dans une pratique vivante et risquée d’un art, ni de ceux qui respectent les artistes qui savent, eux, que le souffle plus où l’art se manifeste ne dépend pas de l’acquisition d’un savoir faire ni de la “ possession ” d’une culture.
(3) Le Monde, 5 mai 2004, p. 5.
(4) Howard Zinn, “ L’ultime trahison ”, Le Monde diplomatique, avril 2004, p. 16-17. Il est question de “ la visite-éclair du président Bush en Irak à l’occasion de Thanksgiving, en novembre 2003, dont la presse s’est si généreusement fait l’écho”
(5) Virginia Woolf, Trois guinées (1938), traduction et préface de Viviane Forrester(1977), La Flèche, Éditions des femmes, 10/18, 2002, p. 67.
(6) Virginia Woolf, ibid., passim.
(7) Albert Camus, Le mythe de Sisyphe (1942), Paris, Gallimard, 95è éd.1956, p.15.
(8) Virginia Woolf, Trois guinées, op. cit., p. 56.
(9) Camus, ibid, p. 28.
(10) Jacques Semelin, “ Massacres ” et “génocides ”, Le Monde diplomatique, avril 2004, p. 3.
(11) “ Journal ” de Virginia Woolf, in Instants de vie (1976), trad. C.M. Huet (1986), préface de Viviane Forrester, Paris, Stock, coll. Biblio, p. 74.
(12) Conférence de Virginia Woolf, ibid., p. 218. Fils du premier mariage de leur mère, les Duckworth étaient très riches alors que les “ petites Stephen ” : Virginia et Vanessa, leurs demi-sœurs, aussi belles que leur mère, mais orphelines de mère et de père, connaissait la grande pauvreté financière des “ filles d’hommes cultivés ” et, par conséquent, la domination de leurs demi-frères aînés.
(13) Georges Bataille, dans L’expérience intérieure, parle des livres de Marcel Proust comme “ les modernes Mille et une nuits ”.
(14) Cité par Bataille, L’expérience intérieure, ibid.
(15) Cf le très beau texte de Nathalie Sarraute à ce sujet : L’usage de la parole, Paris, Gallimard, Folio, 2002, p. 11-18.
(16) Ibid, p. 11.
(17) Instants de vie, ibid., p. 68.
(18) Cité par Viviane Forrester, préface de Trois guinées, op. cit., p. 21.
(19) Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, op. cit., p. 328-329.


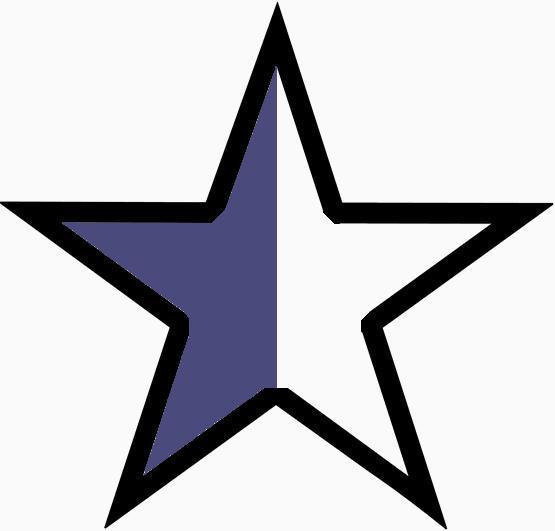
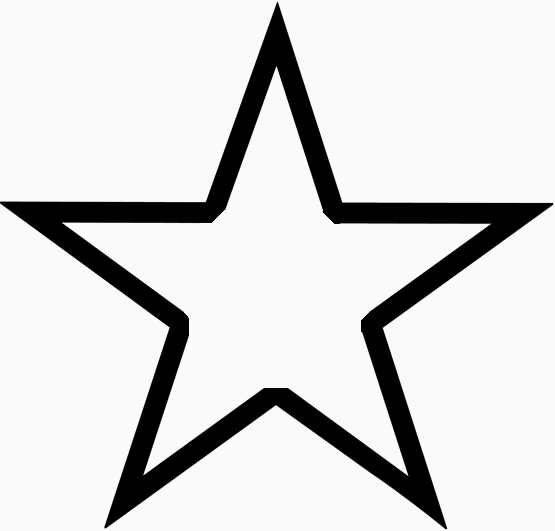


 Actualités
Actualités













