

La Bonté des maîtres du monde
Source : François de Bernard
Philippe, roi de Macédoine, père d'Alexandre :
Que faisaient les maîtres d'autrefois ? Tout autant que de frapper les esprits par des actes exemplaires (telle Cité rebelle entièrement rasée et tous ses habitants rescapés vendus comme esclaves), ils s'efforçaient d'inspirer la peur par des paroles menaçantes proférées sur un ton impressionnant. Ainsi Démosthène, dans sa première Philippique résume-t-il la forme de domination alors exercée par le roi de Macédoine sur les Grecs : «Pour l'instant, (dit-il) tout le monde a peur et se terre, privé de soutien par votre molle indifférence : aussi, je le répète, il est temps de réagir ! Voyez en effet, citoyens d'Athènes, où nous en sommes, et à quel degré d'impudence cet homme est arrivé. Il ne vous donne même pas le choix d'agir ou de rester tranquilles : il profère des menaces, tient des propos arrogants, et, loin de s'en tenir à ses premières conquêtes, il accroît sans cesse son territoire et tend ses filets autour de nous qui restons sans rien faire, à temporiser. »
Le pouvoir de Philippe apparaît d'emblée biface : il est d'abord celui qui fait peur (qui fait rentrer sous terre...) par ses mises en garde, avant d'être celui qui en donne des motifs tangibles (les massacres qui scandent ses conquêtes). Son «empire» (son imperium) est d'abord celui de la langue, avant que d'être un ensemble de territoires arrachés au fil de l'épée. Sa suprématie apparaît enfin dans le fait qu'il ne «donne pas même le choix d'agir ou de rester tranquilles». En combinant l'exercice de la parole terrifiante et celui de la pure force militaire, il balise et contrôle tout l'espace disponible : tel le cobra, il tétanise l'adversaire avant même de l'avoir frappé. Et ce faisant, il accumule les victoires, il élargit toujours plus les limites de son empire, il «tend ses filets autour (des Grecs) qui rest(ent) sans rien faire, à temporiser» - abasourdis qu'ils sont par sa méthode, sa détermination et sa célérité.
Il est celui dont le verbe impérieux annonce les actes, les accompagne et les prolonge - évitant en bien des cas que bataille soit même livrée, la rendant inutile en provoquant la défection de l'adversaire.
De son côté, Démosthène s'emploie à démonter cette belle mécanique arrogante du chef macédonien, en stimulant l'amour-propre, sinon l'orgueil des Athéniens : «Sans doute, Athéniens, ce qui nous arrive fait-il honte à quelque dieu. Ce doit être lui qui inspire à Philippe ce débordement d'activités (...) Mais comme il ne cesse d'attaquer et de viser toujours plus grand, il finira peut-être par vous sortir de votre indifférence, si toutefois vous n'avez pas renoncé à tout espoir. Quant à moi, je m'étonne qu'aucun d'entre vous ne s'interroge ni ne se mette en colère en voyant qu'une guerre commencée pour punir Philippe n'a plus, pour finir, qu'un motif : être épargné par Philippe !» (1ère Philippique)
Ainsi, la crainte suscitée par Philippe doit-elle se transformer en colère devant la lâcheté qu'elle dévoile. Elle le doit - elle n'a pas le choix - car cette terreur qu'attise Philippe entretient la terreur, elle la nourrit comme un incendie dévastateur, de telle sorte que rien ne lui résiste plus : «Il est clair qu'il ne s'arrêtera pas si nul ne lui fait obstacle. Eh bien ! allons-nous attendre passivement la suite ?» Démosthène taille donc en pièces avec obstination les arguments faibles des pleutres, des collaborateurs potentiels, des diplomates, des indifférents, des hésitants... pour leur faire valoir que la crainte présente n'est rien au regard de la vraie menace future, et qu'il faut prendre les armes sans tarder. Pourtant, il échoue à convaincre lors de son premier discours, sûrement à cause de sa jeunesse et de cette impétuosité qui irritent ses pairs, mais aussi parce que ce premier assaut reste un peu «léger», et qu'il manque en fait un ressort fondamental à son analyse.
Ce ressort, il va l'élaborer et le mettre en scène admirablement dans son discours suivant, consacré aux «événements de Chersonèse». Là, il développe l'argument essentiel qui lui manquait dans son entreprise de «déconstruction», celui qui simultanément fournit une interprétation cinglante du «phénomène Philippe» et justifie le mieux possible la mobilisation athénienne contre l'envahisseur. Cet argument, le voilà :
«Tout d'abord, Athéniens, sachez sans l'ombre d'un doute que Philippe est en guerre contre notre Etat (...) Mais c'est surtout à notre régime politique qu'il est résolument hostile, et, s'il est une chose qu'il aimerait trouver, c'est le moyen d'en finir avec notre démocratie. D'une certaine façon, il n'a pas tort : fût-il maître de tout le reste, il sait bien, tant que vous êtes en démocratie, qu'il ne peut être sûr de rien : qu'il subisse un de ces revers auxquels tout homme est exposé et tout ce qu'il a réuni par la contrainte refluera vers vous pour y trouver refuge. Car ce n'est pas pour vous agrandir aux dépens d'autrui et imposer votre domination que vous êtes doués, non ! Vous êtes, vous, habiles à empêcher ou à faire cesser toute domination, en un mot, prêts à vous mettre en travers de ceux qui veulent dominer, et à réclamer la liberté pour tous les hommes ! C'est pourquoi il ne veut pas laisser la liberté qui règne chez vous guetter les occasions de s'attaquer à lui ; il ne le veut à aucun prix et en cela il ne fait pas un mauvais calcul.»
Tout est ici résumé et enfin clarifié aux yeux des intéressés : les véritables enjeux de la menace macédonienne, mais aussi la conclusion qui s'impose, la seule possible : «Commencez donc par tenir Philippe pour l'ennemi implacable de notre constitution et de la démocratie. Si, de cela, vous n'êtes pas intimement persuadés, comment accorderez-vous la moindre importance à ce qui se passe ?»
La finesse de l'argument de Démosthène tourne autour du concept de crainte, qu'il travaille et réussit à retourner, ce qui lui permet une avancée décisive par rapport à la 1ère Philippique. En substance, dans celle-ci, il expliquait qu'il ne fallait pas craindre l'attaquant (mais se préparer à l'affronter et le combattre) parce que cette crainte lui ouvrait un boulevard, et lui permettrait d'aller jusqu'au bout. Mais, dans le discours sur les «événements de Chersonèse», il fait beaucoup mieux. En effet, il ne se contente plus d'opposer l'inquiétude des Grecs à l'arrogance de Philippe, mais il oppose désormais une crainte manifeste (celle des Grecs) à une crainte occultée ou qui n'a pas été distinguée, et qui est précisément celle de Philippe. Il souligne que l'attaque de l'ennemi est en fait guidée par sa propre crainte du grave péril pour lui que porte en soi-même le régime démocratique athénien. Cette «arme absolue» que représente la démocratie, c'est elle que Philippe veut rageusement démanteler, parce qu'il sait qu'elle fait peser une menace permanente sur son entreprise de domination. D'un côté, on trouve celui qui domine sur la scène du monde d'alors ; d'un autre côté, ceux qui dominaient auparavant, mais qui ont aussi le talent, la capacité, l'habileté «d'empêcher ou de faire cesser toute domination», «prêts (qu'ils sont) à se mettre en travers de ceux qui veulent dominer». La rivalité entre Athènes et Philippe prend ainsi une dimension sans commune mesure avec celle à laquelle le petit débat quotidien sur l'Acropole - qui exaspère Démosthène - la réduisait (est-il vraiment dangereux ? ne peut-on pas se jouer de lui ? n'a-t-on pas intérêt à pactiser ? etc.). Car la lutte dont il est question est bien une lutte à mort entre deux conceptions du pouvoir et du monde - et rien de moins. Lutte à mort entre, d'une part, celui qui ne peut étancher sa soif de domination, qui ne s'arrêtera jamais, et envers qui il ne faut nourrir aucune naïveté (comme les «Olynthiens Euthycratès et Lasthérès, qui croyaient être ses amis intimes : après qu'ils eurent livré leur cité, ils ont connu la plus misérable des fins») ; et, d'autre part, ces empêcheurs-de-dominer-sans-fin qui «réclament la liberté pour tous les hommes!»
Alexandre, le fils, et maître du monde en devenir :
De son côté, Alexandre apparaît d'abord comme celui qui est accablé par une domination telle qu'elle ne lui laisse pas non plus d'espace ou de choix : à savoir, encore une fois celle de son père Philippe, mais en un sens naturellement différent de celui des Athéniens. Ainsi Plutarque décrit-il son désarroi de jeune homme qui ne voit plus de lieu où inscrire son nom pour l'Histoire : «Toutes les fois qu'on venait lui apprendre que Philippe avait pris quelque ville considérable, ou qu'il avait remporté une grande victoire, loin d'en montrer de la joie, il disait à ses compagnons : « Mes amis, mon père prendra tout ; il ne me laissera rien de grand et de glorieux à faire un jour avec vous. »»
Alexandre ne supporte nullement d'être relégué au même rang que ceux qui subissent le pouvoir de Philippe et ne sont que ses sujets. Dans cette déclaration, qui exprime la profondeur de son dépit et de sa frustration, on peut aussi voir la clé du personnage exceptionnel qu'il va devenir, en trouvant le moyen de dépasser ce dépit et cette frustration pour faire «mieux encore» (d'un certain point de vue) que son père : «Il pensait que plus l'empire que son père lui laisserait aurait d'étendue, moins il aurait d'occasions de s'illustrer par lui-même ; et (...) il désirait, non d'avoir de la richesse, du luxe et des plaisirs, mais de recevoir des mains de son père un royaume où il eut à faire des guerres, à livrer des batailles, à recueillir une vaste moisson de gloire.»
De ce point de vue, l'épisode fameux du cheval Bucéphale est très éclairant : c'est lui qui va légitimer aux yeux de tous - à commencer par son père -les ambitions d'Alexandre, alors que celui-ci n'est encore qu'un jeune prince dans les mains d'«un grand nombre de maîtres et de gouverneurs (qui) veillaient à son éducation». Un épisode dans lequel, on va le voir, la langue de ces deux maîtres (l'un, absolu : Philippe ; l'autre, en puissance : Alexandre), leur passe d'armes verbale, va jouer un rôle peut-être plus important encore que la performance du cavalier.
On se rappelle que personne ne parvenait à monter Bucéphale, ce cheval que Philonicus voulait vendre à Philippe. On a peut-être oublié que, comme le note Plutarque : «il ne pouvait supporter la voix d'aucun des écuyers de Philippe». D'où il résulte que Philippe, «mécontent», et renonçant à son acquisition, «ordonna qu'on l'emmenât». C'est alors qu'Alexandre fait son entrée dans le monde, avec cette exclamation (qui en dit long sur sa frustration), dont notre narrateur précise qu'il «ne put s'en empêcher» : «Quel cheval ils perdent là par leur inexpérience et leur timidité !» Il faut bien mesurer l'importance de la provocation de ce blanc-bec, et sa perfidie à l'égard de son père, maître du monde d'alors, et pris ainsi à partie devant de nombreux témoins.
C'est pourquoi il est indispensable de citer mot à mot le passage : «Philippe, qui l'entendit, ne dit rien d'abord ; mais Alexandre ayant répété plusieurs fois la même choseSans doute, reprit Alexandre, je le conduirais mieux qu'eux. - Mais si tu n'en viens pas à bout, quelle sera la peine de ta présomption ? - Je paierai le prix du cheval,» repartit Alexandre. Cette réponse fit rire tout le monde ; et Philippe convint avec son fils que celui qui perdrait paierait les 13 talents.» Avant de poursuivre vers le terme que vous connaissez, faisons une pause ici pour évaluer l'incidence de cette joute oratoire. Car il n'y est, naturellement, question d'autre chose que de maîtrise et des enjeux qui y sont liés.
Avant cet échange, il n'est, en effet, qu'un seul chef en Macédoine - roi et stratège militaire incontesté. Or, il suffit d'une petite phrase perfide («Quel cheval ils perdent là par leur inexpérience et leur timidité !»), répétée à plusieurs reprises devant ce chef qui ne veut pas l'entendre, mais finit par y être contraint et prend la mouche, pour que le doute s'insinue et que tout bascule. Alors, père et fils croisent le fer comme des égaux - le second s'étant battu violemment pour cette reconnaissance, en martelant sa contradiction ; le premier lui concédant l'espace nécessaire pour s'y introduire et se faire valoir «aux yeux du monde». Alors, tout ce monde, qui a bien voulu rire de la pirouette du jeune prince, est simultanément conduit à ouvrir des yeux différents sur l'intéressé, et, avant même qu'il ne relève son défi, de considérer qu'en Macédoine, il se pourrait bien qu'il y ait plus qu'un maître - c'est-à-dire qu'aux côtés du chef légitime en titre, un chef présomptif vient de s'affirmer là.
La suite vous est connue, et je ne reprendrai pas le détail de cette séance de dressage qui est aussi une «prise de contrôle», pour utiliser une expression financière.
Le narrateur souligne l'intelligence de son sujet, lequel a noté que le cheval «était effarouché par son ombre», et décide en conséquence de lui tourner la tête vers le soleil. Prouvant «l'inexpérience» des écuyers précédents, qui lui avaient fourni l'argument de sa controverse, il domine la colère du cheval en le «flattant doucement de la voix et de la main» - alors que l'animal ne supportait la voix d'aucun autre... Enfin, il l'enfourche «avec la plus grande facilité», puis, «quand il voit sa férocité diminuée», il «lui parle d'une voix plus rude», et «le pousse à toute bride», devant «Philippe et toute sa cour, saisis d'une frayeur mortelle»... jusqu'au moment où cette assemblée le voit revenir avec aisance.
Il est vrai que dans ce passage héroïque, tout serait également bon à prendre. Mais on en retiendra au moins ceci que le diplôme de maîtrise décroché là par notre jeune prince est effectivement en bonne part un exercice langagier, dans lequel il manifeste avec talent savoir souffler le chaud et le froid sans transition, ce qui est précisément l'art des maîtres - d'abord, le «flattant doucement de la voix», puis parlant «d'une voix plus rude» à ce cheval d'un tempérament comparable au sien, et dont chacun comprend bien que seul un grand chef pouvait le dompter.
C'est cette reconnaissance qui soulève l'enthousiasme de l'assistance à son retour, à commencer par celui de Philippe qui «serre étroitement dans ses bras» son fils et lui déclare avec solennité : «Mon fils, cherche ailleurs un royaume qui soit digne de toi ; la Macédoine ne peut te suffire.» Parole d'un maître à celui qui l'est devenu, à l'occasion d'une épreuve d'initiation provoquée, et dont l'enjeu était précisément une telle confirmation : d'abord, je critique ouvertement l'insuffisance des écuyers du roi ; puis, j'annonce clairement que je ferai mieux qu'eux ; enfin, je le fais. Avec, au terme de ce bref parcours, l'adoubement par le père.
Mais, au-delà de l'examen de passage machiné et réussi, ce qui intéressera dans cet épisode, c'est l'idée du chef qui doit savoir manier simultanément douceur et brutalité pour s'imposer. C'est cette leçon de «savoir-être-chef» que donne Alexandre à l'assemblée présente au «dressage» de Bucéphale. En effet, il débute sur un mode brutal en agressant ceux qui ont failli à leur mission. En suite de quoi, son père est contraint de reprendre la main et de le rudoyer à son tour (car comment l'impressionnant Philippe pourrait-il tolérer le dérapage de son rejeton ?). Alexandre se radoucit alors, et engage sur ce mode serein son dressage - ce qui lui réussit. Mais, dès qu'il parvient à se hisser sur Bucéphale, il reprend sa "rudesse" afin de diriger le cheval à son gré, jusqu'au moment où son père et lui-même se retrouvent dans un élan d'effusion...
Cette distinction est rien moins qu'anecdotique dans le récit de Plutarque, où celui-ci décrit Philippe d'une manière disons monochromatique, au sens où le roi, comme chez Démosthène, apparaît plutôt brutal et sans guère de nuances, tandis que la particularité d'Alexandre, constante de son adolescence à sa mort, est d'inspirer à ses amis comme à ses ennemis tantôt le sentiment de la crainte et de la déraison, tantôt celui de la bonté et de la sagesse.
Or, cette distinction est beaucoup plus profonde qu'une simple différence de caractère ou de comportement : elle recèle, me semble-t-il, toute une conception du pouvoir qui explique en bonne part la singularité d'Alexandre.
Car Alexandre ne peut se contenter d'accumuler les victoires ; il ne se suffit pas d'être un «maître de guerre» accompli, tel que son père ; il veut aller beaucoup plus loin ; il veut, d'emblée, s'imposer comme maître du monde - et pas seulement du monde physique, mais aussi bien de celui de l'esprit.
Un autre passage des Vies permet de mesurer le caractère «planétaire» de cette ambition. Et ce passage concerne - cela ne peut nous laisser indifférent - un certain Aristote, maître vénéré, alors considéré comme le meilleur (ce que l'on ne saurait démentir), et que son père est allé quérir pour «parfaire l'éducation» du jeune prince. C'est donc le moment où Alexandre, ayant hérité du pouvoir macédonien, formule un reproche amer à l'égard d'Aristote : celui d'avoir publié son enseignement, et en particulier la métaphysique. Que dit-il ? «Alexandre à Aristote, salut. Je n'approuve pas que vous ayez donné au public vos livres de sciences acroamatiques (enseignement ésotérique de certains philosophes donné verbalement à des auditeurs, d'après Bailly). En quoi serons-nous donc supérieurs au reste des hommes si les sciences que vous m'avez apprises deviennent communes à tout le monde ? J'aimerais encore mieux les surpasser par les connaissances sublimes que par la puissance. Adieu»
On voit bien de nouveau la frustration ressentie par celui qui ne veut pas seulement s'imposer au monde par les armes, mais qui souhaiterait au moins autant «surpasser (les autres hommes) par les connaissances sublimes». Et simultanément, on a du mal à imaginer Philippe signant un tel message.
C'est qu'Alexandre met en scène, avec cet aveu de faiblesse assez incongru, une conception toute particulière du pouvoir, que l'on peut résumer ainsi : ne devient vraiment maître du monde que celui qui le domine entièrement, c'est-à-dire non seulement par l'épée mais aussi par la langue et par le concept. Une idée de la domination par la langue et le concept singulière, car elle repose sur le principe d'occultation : il faudrait éviter de livrer nos codes secrets, nos savoirs exclusifs, et les dissimuler aux yeux des simples mortels, de tous ceux qui ne sont pas faits pour régner, mais pour être guidés. Posture assez naïve à laquelle Aristote objecte, «pour consoler cette âme ambitieuse et pour se justifier lui-même», et s'il faut en croire Aulu-Gelle, cette fois : «Aristote au roi Alexandre, salut. Vous m'avez écrit au sujet de mon livre sur les sciences acroamatiques, pour me dire que j'aurais dû les laisser parmi les choses secrètes. Sachez donc qu'ils sont publiés et qu'ils ne le sont pas, car ils ne peuvent être compris que par ceux qui m'ont entendu en discourir. Adieu.» (Nuits attiques)
En amateurs, vous apprécierez cette belle leçon subsidiaire administrée au jeune roi, qui n'en demandait pas tant. Car nous n'en sommes plus à l'âge des «maîtres de vérité en Grèce archaïque», pour reprendre l'expression de Marcel Détienne. Nous n'en sommes plus à une époque où l'archonte et les prêtres sont seuls à détenir les clés de cette parole véridique ou mensongère dont ils font usage à leur gré pour diriger la Cité. Nous sommes en un temps post-socratique où le savoir se diffuse, se discute, est objet de délibération : un temps où il serait ridicule de vouloir le retenir, le cantonner, entraver sa publication... Mais cela ne signifie pas pour autant que d'être ainsi publié le rend accessible à chacun, au «reste des hommes», à la foule. Le «vrai maître» ne craint pas la publication de son enseignement, parce qu'il sait qu'elle ne donne ni les clés de sa compréhension ni celles du pouvoir : c'est ce qui distingue Aristote et Alexandre. Le premier n'a pas d'inquiétude ; le second croit qu'on peut lui voler sa domination (ou s'en émanciper) par le seul fait de lire La Métaphysique...
Hiéron et Simonide :
Avec le Hiéron de Xénophon, nous avons encore affaire à une autre mise en perspective de l'articulation domination/crainte, qui me semble enrichir les précédentes.
On se rappelle que le tyran Hiéron se lamente auprès de Simonide de cette pression jamais relâchée que fait peser sur lui l'exercice de sa tyrannie (on appellerait ça aujourd'hui «un stress permanent») : cette pression imputable, d'une part, au fait que ses sujets sont (généralement !) mécontents d'un tel régime et de son arbitraire, d'autre part à celui, conséquent, que le tyran se sent perpétuellement menacé. Ce que Hiéron résume ainsi : «Les tyrans ne sont jamais en paix avec ceux qui subissent leur tyrannie ; jamais le tyran ne saurait se fier à une trêve et être tranquille (...) Puis, une fois qu'ont péri tous ceux qu'il redoutait, loin d'en être plus tranquille, il redouble de précautions. C'est donc une guerre que le tyran soutient sans cesse.»
Sous la tyrannie, il est ainsi deux formes de crainte concurrentes : celle de la masse des tyrannisés, qui ont tout à redouter de l'arbitraire du pouvoir en place ; et celle du tyran lui-même, toujours aux aguets d'éventuelles représailles de la part de ceux qu'il oppresse. La domination qu'il exerce est à ce prix d'une inquiétude sans fin, que rien ne peut vraiment apaiser - rien d'autre que la mort de l'intéressé... ou celle de tous ses sujets !
Ce constat assez joyeux est d'autant plus perturbant pour notre tyran que son rêve secret, son désir le plus vif est, précisément, d'être aimé de ses sujets ... «Je regarde comme un bonheur si grand d'être aimé que je trouve que les bienfaits viennent réellement d'eux-mêmes à celui que l'on aime et de la part des dieux et de la part des hommes. (Or) ce bien si précieux est celui dont les tyrans sont privés plus que tous les hommes.» Cruelle contradiction dans les termes, qui ne semble pas pouvoir être résolue, et qu'il évoque auprès de Simonide, afin de partager ce lourd «secret» et sans doute dans l'espoir que son confident suggérera une solution.
Effectivement, au terme d'un entretien où ils s'efforcent d'évaluer les caractéristiques de la fonction, Simonide laisse entrevoir une solution à l'impasse du tyran : «Le découragement que tu éprouves, concernant la tyrannie, ne me surprend pas, car précisément tu désires te faire aimer des hommes et tu penses que c'est elle qui y fait obstacle. (Mais) je crois pouvoir te montrer que le pouvoir n'empêche nullement d'être aimé...»
Certes, il paraît vain d'attendre que des sujets opprimés s'enflamment d'amour pour un tyran qui a multiplié à leur égard spoliations, blessures et autres preuves de cruauté. Pourtant, il n'est pas impensable de modifier le contenu de cette relation mortifère et de renverser, en quelque sorte, l'humeur du peuple. En effet, si le tyran manifeste envers lui une certaine forme de «bonté» qui consiste à apporter la prospérité à la cité et à la faire triompher face à ses concurrentes ; puis, si cette bonté est reconnue par tous ; alors, il est envisageable que le peuple témoigne en retour au tyran un amour sans limites... La nature de la bonté en question se situant sans équivoque sur un plan économico-politique, et même géopolitique, comme l'indique clairement Xénophon : «C'est moi qui te l'affirme, Hiéron ; c'est avec d'autres chefs d'Etat que tu dois entrer en concurrence. Etre celui qui rend le plus prospère la cité dont il est le chef, ce sera pour toi, sache-le bien, remporter la victoire dans le concours le plus beau et le plus magnifique qui soit au monde. En premier lieu, tu réussiras tout de suite à te faire aimer de tes sujets, ce qui est précisément l'objet de tes désirs ; ensuite, il n'y aurait pas seulement un héraut pour proclamer ta victoire, mais tous les hommes célébreraient ta vertu. Tu attirerais tous les regards et non seulement les particuliers, mais un grand nombre de villes te chériraient ; tu serais admiré, non seulement chez toi, mais encore en public chez tous les hommes (...)» (XI,7-10)
Le tyran a donc ainsi tous les avantages à sortir du régime de la pure oppression interne, pour entrer dans celui de la conquête externe, censée apporter bienfaits et richesses à son peuple. Plutôt que de combattre son peuple sans espoir de quiétude, il a tout intérêt à améliorer ses conditions de vie, à accroître son patrimoine, à lui donner des compensations économiques et monétaires à la tyrannie qu'il subit, et ce en rivalisant avec ses égaux : les «autres chefs d'Etat». C'est seulement à ce prix que les sujets emplis de ressentiment, voire de haine, peuvent devenir pour lui des amis - ce qui est son vœ;u le plus cher.
«En fait de trésors, assurément, tu aurais toutes les richesses de tes amis. Allons, courage, Hiéron, enrichis tes amis, tu t'enrichiras toi-même ; accrois la prospérité de la cité, tu augmenteras ta propre puissance ; gagne-lui des alliés. Regarde ta patrie comme ta famille, tes concitoyens comme des camarades, tes amis comme tes propres enfants, tes enfants tout à fait comme ta vie ; efforce-toi de les vaincre tous par les bienfaits. Si, en effet, tu surpasses tes amis par les bienfaits, il n'y a pas de danger que tes ennemis puissent te résister. Si tu fais tout ce que je te dis, sache bien que tu posséderas le bien le plus beau et le plus précieux au monde : ton bonheur ne fera pas d'envieux.» (XI, 14)
On remarquera que ce n'est pas une autre méthode qu'Alexandre s'est efforcé de suivre au long de son périple de conquêtes - et, en effet, il passe pour avoir été aimé de ses compagnons de route envers lesquels Plutarque nous fait savoir qu'il se montrait d'une générosité extrême, privilégiant leur part au détriment de la sienne dans le partage des dépouilles, mais aussi de ses autres concitoyens, qui voyaient grâce à lui la grandeur macédonienne atteindre un sommet.
De Philippe à Bill Gates, en passant par Alexandre et Hiéron ?
Avec Philippe, Alexandre, Hiéron et Simonide, voici donc rappelée une même problématique, celle de la domination - mais sous des rapports différents à la question de la crainte.
En substance :
Philippe utilise l'arme privilégiée de la crainte qu'il inspire pour étendre sa domination sans modération ni limites. Mais Démosthène dévoile la faille de l'armure du conquérant macédonien : sa propre crainte des démocrates, ces empêcheurs de dominer au nom de la liberté, qui seraient seuls à posséder l'antidote à sa progression...
Alexandre veut bien plus que d'accroître son empire par les armes : il veut être reconnu par les hommes pour sa supériorité à tous égards (d'abord, par l'esprit), et sa crainte perpétuelle est de ne jamais y parvenir assez - d'où l'épisode Bucéphale et son reproche adressé à Aristote. Aristote, précisément, ne manifeste aucune crainte - sans doute parce qu'il est un «vrai maître», de la Logique, en particulier, ce qui lui donne l'exclusivité de pouvoir dire qu'une chose est et qu'elle n'est pas (comme ses livres, dont il dit qu'ils sont publiés et qu'ils ne le sont pas)...
Hiéron, enfin, vit dans la crainte perpétuelle de la menace sur sa vie que représentent tous ceux qu'il tyrannise. A quoi Simonide suggère comme solution pour apaiser cette crainte et maintenir sa domination de prouver sa «bonté» en réalisant le projet de rendre sa cité la plus prospère !
Dans cette galerie de «maîtres anciens», se dégagent ainsi trois figures de la domination incarnées par les personnages historiques ou fictifs décrits par Démosthène, Xénophon et Plutarque :
- Philippe, tout d'abord, correspond à la figure traditionnelle du «maître terrible», soulignée par les organisateurs du présent colloque : «Les maîtres anciens parlaient d'une voix majestueuse ou terrible, celle de la souveraineté. Ils faisaient fond sur l'autorité et la terreur légale.»
- Alexandre, ensuite, représente une figure que je situerais à mi-chemin entre les maîtres anciens et les maîtres d'aujourd'hui : c'est qu'Alexandre, bien que fils de son père et grand conquérant, manifeste durant toute sa fulgurante carrière, être préoccupé par bien autre chose que la domination territoriale. Son besoin de régner sur les esprits et sur les cœ;urs de ses sujets, sa façon même de traiter ses ennemis, en font un «maître complexe» qui joue et s'impose au monde sur des registres différents ;
- Enfin, le Hiéron de Xénophon, «relifté» par la voix de son Conseil en communication Simonide, ouvre la voie au second volet du constat, qui concerne les maîtres d'aujourd'hui, ceux que l'on pourrait nommer les «maîtres absents» : «La langue des maîtres est désormais vouée à cette nouvelle tâche : valider la domination comme absence de domination. Elle prend en charge le discours des dominés (...) Les maîtres d'aujourd'hui parlent une langue dépassionnée, celle de l'expert, qui affirme les principes de l'efficacité, censés être étrangers à la logique du pouvoir.»
Sans doute ne peut-on rapprocher abusivement la suggestion de Simonide de celle de « l'expert » contemporain. Pourtant, leurs positions ont ceci de commun que dans les deux cas il s'agit de déplacer la question de la domination en gommant la «voix majestueuse ou terrible». D'un côté, Simonide conseille à Hiéron de faire oublier sa tyrannie et de provoquer l'amitié des citoyens en lançant la Cité dans une compétition (guerrière et/ou commerciale) avec ses rivales, favorisant ainsi (ou laissant miroiter) l'accroissement de la prospérité de tous. D'un autre côté, l'expert d'aujourd'hui prétend être seulement guidé par l'obsession d'une efficacité qui serait mise au service de la société, et non par la quête du pouvoir.
Il me semble que ces différents repères, a priori éloignés, définissent bien par leur rapprochement le mouvement à l'œ;uvre au présent, et qui a été nommé : «valider la domination comme absence de domination». Et que c'est à leur croisée que peut prendre tout son sens la figure d'un personnage aussi emblématique de la scène contemporaine que Bill Gates.
Bill Gates :
Bill Gates, fondateur et dirigeant de Microsoft, dont les systèmes d'exploitation Windows équipent 4 ordinateurs personnels sur 5 dans le monde et dont les logiciels les plus connus (Word et Excel) sont utilisés par la plupart - Bill Gates a développé cette activité qui a fait de lui l'homme le plus riche du monde (un patrimoine évalué à environ 90 milliards de dollars, soit environ 600 milliards de francs).
Mais ce qui nous intéresse en lui, c'est cette «bonté» qu'il diffuse naturellement, avec son visage et son sourire poupins, ses baskets et sa façon informelle de parler, cette «amitié» qu'il semble témoigner au grand nombre et qui lui est bien rendue, puisqu'il est devenu un personnage hautement populaire dans son pays et dans le monde entier. C'est que Bill Gates ne veut rien de moins - il l'a déclaré solennellement le 13 janvier 2000 à ses employés dans un message électronique classé de «haute importance» - que de «changer la manière dont les gens travaillent, communiquent et se divertissent» (1). Il vient ainsi de mettre un terme à un quart de siècle de présidence de Microsoft pour mener à bien cette noble mission lors des années à venir. Mieux, il se contente désormais du nouveau titre, qu'il s'est attribué, de «directeur de l'architecture logiciels» avec une modestie qui mérite louange. Bill Gates, le maître de nos ordinateurs, l'homme de Windows, de Word et d'Excel, celui par qui, en quelque façon, le présent texte s'écrit, celui-là même décide de descendre de son piédestal pour retrouver le sens originel de sa mission, et - semble-t-il plus encore - pour mieux nous retrouver, mieux comprendre nos besoins et y répondre, pour manifester son amour des gens... C'est à l'aune des risques étonnants ainsi pris par l'intéressé que l'on jugera de sa bonté - de sa sollicitude pour le genre humain.
Il faut dire qu'il n'en est pas à son coup d'essai, et qu'il a le talent de vendre son nouveau projet (la bourse américaine a fort bien accueilli cette annonce), puisqu'il prétend avoir déjà réussi à «placer un ordinateur dans chaque bureau et dans chaque maison», ce qui fait assurément de lui un bienfaiteur de l'humanité. C'est là une prétention un peu extravagante, puisque Bill Gates n'a jamais construit d'ordinateurs, seulement des systèmes d'exploitation et des programmes, mais qu'importe ? Qui se soucie de la distinction, du moment que les ordinateurs sont bien là ? Les logiciels de Microsoft sont réputés, chez les informaticiens, pour leur inefficience, leur lourdeur et leurs bogues - mais qu'importe ? N'ont-ils pas généré le plus important succès commercial et financier du dernier quart de siècle ? Le véritable étalon est là, le seul qui compte : le succès, la popularité, la diffusion massive des produits du maître. Que celui-ci se révèle plutôt maître en marketing qu'en industrie, qu'importe ? Que son talent soit plutôt de faire vendre au monde entier de «mauvais produits» que d'en développer de «bons», qu'importe ? Force est de constater que la voix des experts de second rang qui émettent ce diagnostic-là (des rabat-joie, des méchants, des aigris ?...), leur voix est de bien peu de poids en face de celle de la mécanique Gates qui souligne la beauté du geste d'avoir équipé tant de foyers qui vivaient encore à l'Age de pierre. D'ailleurs, nos grands politiques ne se sont pas privé de lui donner raison en le recevant comme un chef d'Etat lors de sa tournée des capitales européennes. Et, si l'on en croit Lewis Lapham (2), les participants du Forum de Davos ne s'y trompèrent pas non plus, en 1998, à l'occasion de son passage en ce lieu de pèlerinage : «L'auditoire se transporta dans la salle mitoyenne pour y écouter Bill Gates, l'homme le plus riche de la chrétienté (...) Les journalistes massés dans la salle faisaient penser à des bergers venus assister au miracle de Bethléem. Il revint à David Gergen, autrefois rédacteur des discours de Richard Nixon et Ronald Reagan, d'adresser un compliment à l'orateur : «Votre nom, Monsieur, est indissolublement lié au vingt-et-unième siècle» Gates resplendissait d'optimisme et d'allégresse (...)»
D'où il appert que l'arrogance des maîtres a bien changé de forme, mais non de but. La voix terrible n'est, en effet, plus nécessaire, pas plus que les échos de massacres, pour inquiéter les cités et s'imposer comme maître du monde. Il y suffit du discours de l'évidence, de la petite musique de la satisfaction universelle et de mérites auto attribués sur le ton de la confidence, avec un sourire angélique. Ce qui valide, plus que jamais, la justesse de la suggestion de Simonide : «Etre celui qui rend le plus prospère la cité (...) , ce sera pour toi, sache-le bien, remporter la victoire dans le concours le plus beau et le plus magnifique qui soit au monde. En premier lieu, tu réussiras tout de suite à te faire aimer de tes sujets, ce qui est précisément l'objet de tes désirs ; ensuite, il n'y aurait pas seulement un héraut pour proclamer ta victoire, mais tous les hommes célébreraient ta vertu (...)» Il semble que Bill Gates ait entendu et mis en actes la leçon de Xénophon.
C'est que vouloir «changer la manière dont les gens travaillent, communiquent et se divertissent» est un projet qui n'est pas anodin et qui ne manquera pas de susciter l'enthousiasme du public davosien, à défaut de susciter celui du milliard de personnes (au moins) qui n'ont simplement pas accès à l'électricité. une ambition planétaire dont chacun mesure la force et la radicalité. Une ambition qui lève le masque de l'amitié souriante pour rappeler celui, grimaçant, de la tyrannie ordinaire. Une affirmation qui n'aurait certainement pas laissé indifférent un George Orwell.
Il faut dire que le maître sait doser ses effets, et témoigner à la fois de modestie et de désintéressement : «Je retourne à ce qui me plaît le plus : me concentrer sur les technologies du futur .» Comprendre : j'abandonne le pouvoir, qui ne m'intéresse pas, pour me consacrer à l'avenir de l'humanité, qui est le plus beau projet. Soit encore : «valider la domination comme absence de domination», ainsi que le soulignaient les organisateurs de la présente rencontre.
Autre preuve de simplicité et d'authenticité : «J'ai décidé de me créer une nouvelle fonction, directeur de l'architecture logiciels, qui me permettra de consacrer 100% de mon temps au développement de nos produits.» Comprendre : je renonce au leadership, je redeviens un maillon de la grande chaîne d'amitié (qui permet de réaliser nos merveilleuses inventions) afin d'être plus productif pour Microsoft et pour le monde entier.
Jusque là, ce jeune patron, qui considère que rester PDG d'une entreprise de ce secteur pendant 25 ans est «plutôt inhabituel», force la sympathie. Qui ne lui adresserait, en effet, un label de «modernité» ?
Pourtant, les plus habiles se trahissent toujours, et celui-là n'y fait pas exception. En effet, il prend la peine, le jour même de l'annonce de sa «démission de PDG», de préciser par un message électronique à ses employés : «Si certains d'entre vous imaginent que cette décision signifie que je consacrerai moins de temps à Microsoft, ils ne peuvent être plus éloignés de la réalité». Et ici, la menace n'est plus qu'à peine voilée : - N'allez surtout pas imaginer, chers amis subordonnés, que je me retire, et que je ne serai plus à même de surveiller étroitement chacun de vous et ses prestations réalisées pour la société mondiale que j'ai fondée et que je contrôle. En vérité, ce retrait du devant de la scène managériale ne doit nullement être interprété comme une «perte de pouvoir» de l'intéressé, mais au contraire comme le signe d'un pouvoir accru. Qui peut, en effet, parmi les grands capitaines d'industrie contemporains, se permettre une telle liberté ? Seuls les plus puissants, assurés qu'ils sont de continuer à tirer toutes les ficelles sans restriction - tel, en France, un Claude Bébéar, dont le retrait annoncé de la présidence du Groupe AXA, ne signifie aucune baisse d'influence dans le milieu des affaires, en particulier sur les alliances et les luttes que poursuivent les groupes - et ce à la façon d'un Ambroise Roux dans les années 1980, resté patriarche du patronat après son départ de la tête de la CGE.
Cette petite phrase : «Si certains d'entre vous imaginent que cette décision signifie que je consacrerai moins de temps à Microsoft, ils ne peuvent être plus éloignés de la réalité» résonne comme un avertissement très clair. C'est qu'il ne faudrait tout de même pas prendre les choses au pied de la lettre
En apparence, je m'en vais, je me déplace... pourtant, je reste ! Et, non seulement je garde de fait la fonction précédente - même si je me débarrasse de son titre et des lourdeurs inhérentes - mais j'en crée une autre qui me permettra d'étendre mes pouvoirs - et non de les restreindre ! Que ceux qui rêvent rêvent donc, mais ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas... C'est ici que l'on voit se dessiner les limites de la «bonté» de Bill Gates : il n'est pas exactement cet homme sage et plein de spiritualité que l'on nous décrit parfois, et qui, fortune faite, se retirerait dans son laboratoire pour la cause du progrès de l'humanité ; mais bien plutôt celui qui, abandonnant le premier plan hiérarchique, se met en position de contrôler encore mieux ses troupes, ses ennemis et le « reste du monde ». Le retrait, la vacance annoncée ne sont en fait que le présage de conquêtes plus subtiles, mais aussi beaucoup plus étendues.
Le personnage Gates est ainsi très intéressant, parce qu'il incarne admirablement, avec son sourire perpétuel, ses bonnes manières et ses généreuses intentions, cette forme contemporaine de la domination qui use sans modération de «la bonté» et de «l'amitié».
La domination sous sa forme brutale, physique, terrifiante au premier regard, n'est plus de mise pour ce paradigme des nouveaux maîtres - simples, normaux et même communs, sympathiques, en chandail et baskets. Elle quitte son apparence ordinaire, cette domination, elle s'absente pour mieux s'imposer sous une forme dématérialisée : la domination que l'on ne voit plus et que l'on n'entend plus (sauf à y porter une vive attention). L'important, comme pour Hiéron, c'est d'être aimé... de faire oublier la violence de la domination, afin de mieux l'étendre. Car, «changer la manière dont les gens travaillent, communiquent et se divertissent», avoir seulement l'idée de ce projet, puis le former, le concevoir, avoir l'ambition de le réaliser, délaisser les honneurs d'une présidence prestigieuse pour s'y consacrer à 100%, après avoir déjà réussi à s'introduire dans chaque foyer, chaque bureau - cette démarche ne correspond-elle pas à une quête de domination encore plus perverse, sinon extrême, que celle exercée par la violence physique? Changer les gens, leur langage, leurs modes de travail et de communication, leurs loisirs : quel est donc ce projet qui n'a rien à envier à l'appétit illimité de conquête des maîtres d'autrefois ou de naguère ? Quel est son propos, et vers où se dirige-t-on ainsi ? Vers la domination sans nom et sans visage ? Vers la domination banalisée ou «normalisée» ? Vers la domination et le contrôle des esprits ? - je vous en laisse juges.
Notes :
« (...) Aristote, pour consoler cette âme ambitieuse et pour se justifier lui-même, répondit que ces ouvrages étaient publiés et ne l'étaient pas. Il est vrai que ses traités de métaphysique sont écrits de manière telle qu'on ne peut les apprendre seul ni les enseigner aux autres, et qu'ils ne sont intelligibles que pour les personnes déjà instruites. »
Vie, tome 3, p. 306


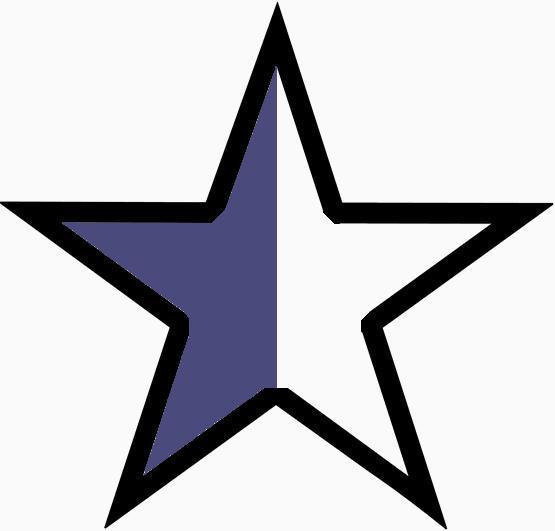
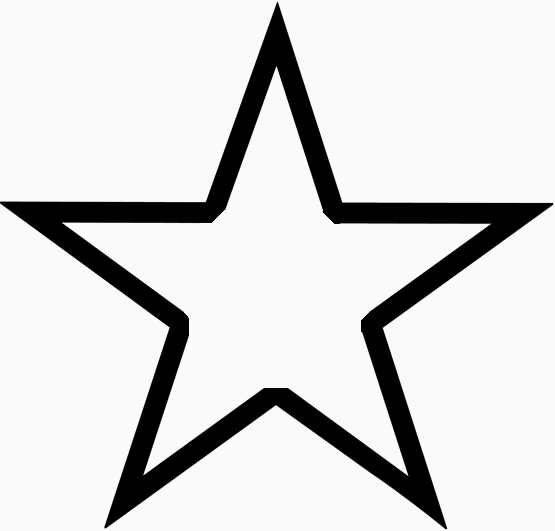


 Actualités
Actualités













